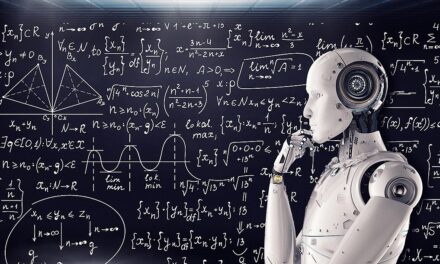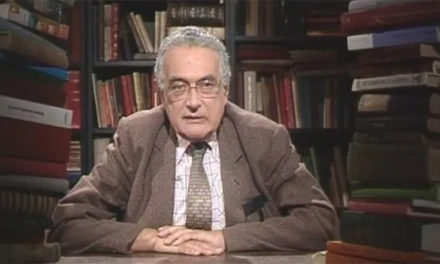Johan Seynaeve est délégué syndical de l’ACOD-Finances d’Anvers et est actif depuis de nombreuses années autour de la demande d’une taxe drastique sur les gros patrimoines. Nous avons eu une discussion approfondie avec lui sur les conséquences sociales et économiques de la crise du Coronavirus et sur ce à quoi pourrait ressembler une approche progressiste et socialement plus juste de la crise.
Un impact économique énorme
Tous les économistes semblent être d’accord : cette pandémie s’accompagnera d’une crise économique plus lourde que celle de 2008. Quelle est l’ampleur du préjudice économique ?
Une différence importante avec la crise de 2008 est que le déclencheur n’est pas un facteur économique intrinsèque. Cette crise économique est déclenchée par un choc externe, non économique, à savoir une maladie grave et très contagieuse.
En outre, il s’agit cette fois d’un choc qui se manifeste directement dans l’économie réelle et non pas seulement ou principalement par une crise du monde financier.
De plus, elle concerne des effets de choc tant du côté de la demande que de l’offre de la production de biens (et dans les secteurs des services, tels que le tourisme et les événements sportifs)
Le manque de médicaments, la gravité de la maladie et sa propagation rapide conduisent dans un premier temps à la mise en quarantaine des personnes infectées, à des confinements nationaux, régionaux (ou locaux), à une réduction drastique de la mobilité et de la distance physique par rapport aux autres.
La reprise dans les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme, des manifestations culturelles et sportives, etc. est encore fortement limitée.
En outre, les activités de diverses entreprises industrielles sont toujours gravement affaiblies par une forte baisse de la demande ou par une réduction de l’offre de composantes et/ou de matières premières. Ou bien la productivité a été réduite en raison des mesures de sécurité nécessaires (principalement la distanciation sociale) ou en raison de la maladie et de la détection d’infections sur le lieu de travail, ou d’une combinaison de ces facteurs.
Le préjudice économique a été jusqu’à présent énorme. Le PIB des pays de la zone euro a baissé de 3,1 % au 1er trimestre et de 15,0 % au 2e trimestre 2020 par rapport à l’année précédente (source Eurostat).
Selon les dernières prévisions du FMI (Perspectives de l’économie mondiale de juin 2020), la production mondiale (d’année en année) devrait baisser de 4,9 % en 2020, le PIB devrait diminuer de 8 % dans les pays industrialisés, de 9,4 % en Amérique latine, de 4,5 % en Inde, de 6,6 % en Russie, de 3,2 % en Afrique subsaharienne, etc. Il n’y a qu’en Chine que le PIB n’augmentera que de 1,0 % en 2020. Selon ce rapport du FMI, le commerce mondial devrait chuter de 11,9 % en 2020 en raison de la réduction de la demande de biens et de services (y compris le tourisme).
Le chômage (dans un nombre limité de pays, principalement sous la forme de chômage temporaire) a énormément augmenté pendant la période de confinement, mais aussi après l’assouplissement des mesures restrictives. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), au cours du premier semestre 2020, le nombre d’heures de travail effectivement effectuées et rémunérées n’a jamais baissé aussi fortement.
Globalement, le nombre d’heures de travail « perdues » au cours du 1er trimestre 2020 est estimé à 5,4 % par rapport au 4e trimestre 2019. Cela correspond à 155 millions d’emplois à temps plein (dans une semaine de 48 heures, dans une semaine de 40 heures, c’est 185 millions). L’OIT(1)Moniteur de l’OIT 5e édition (2020-06-30) estime la perte au 2ème trimestre à 14,0% par rapport au 4ème trimestre de 2019, soit 400 millions d’emplois dans une semaine de 48 heures (480 millions dans une semaine de 40 heures).
En avril, on espérait encore une évolution en V de l’économie mondiale – avec un déclin rapide, suivi presque immédiatement d’une augmentation rapide et d’une altération permanente limitée (cicatrisation) du tissu économique. Cependant, dès le mois de juin (alors qu’il n’y avait pas encore de deuxième vague), le FMI a ajusté le scénario de base en supposant une reprise plus lente.
Cela est dû à la prolongation de mesures telles que la distanciation sociale au cours du 2e semestre 2020, à une dégradation plus importante que prévu du tissu économique et à un impact négatif sur la productivité en raison des mesures de sécurité qui sont et resteront nécessaires pour garantir la sécurité au travail.
Mais un calcul définitif des dégâts est pour l’instant impossible. D’une part, parce que l’infection virale est encore loin d’être maîtrisée. Selon Hans Kluge, directeur européen de l’Organisation mondiale de la santé, le coronavirus pourrait devenir endémique, une « grippe saisonnière » qui revient chaque année et qui doit être poursuivie en permanence avec des mesures plus ou moins restrictives et un vaccin qui doit être réinventé chaque année. D’autre part, la pandémie coronarienne se produit dans le contexte d’une économie capitaliste tardive extrêmement fragile. C’est la raison pour laquelle les conséquences socio-économiques seront particulièrement graves.
Le Covid-19 ne touche pas tout le monde de la même manière
Est-il vrai ,comme certains le prétendent que cette crise touche tout le monde de la même façon : le virus ne distinguerait pas les riches des pauvres ?
Pas du tout. Les rapports sociaux se reflètent également dans cette crise.
Les données du « Intensive Care National Audit and Research Centre » (Centre national d’audit et de recherche sur les soins intensifs – ICNARC) montrent qu’au Royaume-Uni un tiers des malades du covid-19 dans un état critique sont noir.e.s ou issu.e.s des minorités ethniques.
Selon le service national des statistiques du Royaume-Uni (Office for National Statistics), les Britanniques noirs de sexe masculin et les Britanniques noirs de sexe féminin ont respectivement 4,2 et 4,3 fois plus de chances que les Britanniques blancs de mourir de causes liées au COVID-19. Et en Angleterre et au Pays de Galles, le nombre de décès dus à un travail non qualifié est plus élevé que la moyenne des personnes du même âge et du même sexe.
Selon les données du Département de la santé de la ville de New York, les citadin.e.s hispanophones et noir.e.s ont deux fois plus de chances de mourir de la maladie que les New-Yorkais blanc.he.s. À Chicago, le risque de mourir du covid-19 pour les citadin.e.s noir.e.s serait même 5 fois plus élevé que pour les citadin.e.s blanc.he.s.
L’inégalité sociale et économique jouerait un rôle crucial à cet égard. Les minorités ethniques font généralement partie des couches socio-économiques les plus pauvres de la population.
Beaucoup ont un travail mal payé (2)Selon l’ONS, plus de personnes effectuant un travail non qualifié meurent en Angleterre et au Pays de Galles par rapport à la moyenne des personnes du même âge et du même sexe. Al Jazeera, 11 mai 2020 ; https://www.aljazeera.com/news/2020/05/male-security-guards-highest-risk-dying-covid-19-ons200511094644488.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links avec des conditions de travail précaires, généralement sans possibilité de télétravail. En raison du contenu de l’emploi ou pour des raisons financières, iels sont obligé.e.s de continuer à travailler.
Combiné à des conditions de logement précaires (espaces trop petits pour un trop grand nombre de personnes, mélange forcé de générations), cela rend ces personnes issues de minorités ethniques plus vulnérables à l’infection.
De plus, aux États-Unis, ils n’ont souvent pas d’assurance maladie et ne peuvent donc pas payer les traitements.
La Belgique ne fait pas exception. Après une analyse des données, De Tijd a constaté que pendant le petit rebond de juillet, le virus a surtout touché les personnes des quartiers les plus pauvres, les plus jeunes, les plus densément peuplés et les plus colorés (De Tijd du 6/8/2020).
Outre les inégalités des effets sur la santé, il existe également des différences au niveau des conséquences économiques. Des recherches menées aux États-Unis montrent que ce sont en particulier les personnes ayant des revenus relativement faibles, peu qualifiées et jeunes qui sont devenues chômeuses. En avril, le chômage a augmenté de 6 points de pourcentage, à 8,4 %, pour les salariés titulaires d’un diplôme universitaire, et de 14 points de pourcentage, à 21,2 %, pour les travailleurs sans diplôme secondaire. Le taux de chômage global était alors de 14,7 %.
Selon l’Institut Becker Friedman, l’emploi des salariés appartenant aux 20% des revenus les plus élevés a diminué de 9%, tandis que les 20% des revenus les plus faibles ont enregistré une baisse de 35%.
Les problèmes de santé dans les pays en développement sont démultipliés par rapport à ceux des pays industrialisés. Le système de soins de santé de ces pays est absolument incapable de faire face à une telle épidémie.
The economist donne l’exemple de l’Inde et du Pakistan (qui abritent ensemble 1/5e de la population mondiale) : L’Inde n’a que 8 médecins et 7 lits d’hôpital pour 10 000 personnes ; le Pakistan, respectivement 10 et 6. En mars, l’Inde ne disposait que d’environ 40 000 respirateurs en état de marche, un outil essentiel pour sauver la vie des patients gravement malades atteints de coronaropathie. (The economist, 26/3/2020)
La situation est similaire dans d’autres pays en développement. En outre, la « distanciation sociale » est impossible si vous devez survivre dans un bidonville ou un camp de réfugiés. Comment pouvez-vous vous laver les mains s’il n’y a pas ou trop peu d’eau courante ? Des années de malnutrition et de sous-alimentation ont affecté la santé (y compris le système immunitaire) de la population et la rendent plus vulnérable à cette maladie infectieuse supplémentaire.
Comment une mesure de confinement (3)Au cours de la 4e semaine de mars, un embargo a été imposé à 210 millions de Pakistanais et 1,3 milliard d’Indiens. pourrait-elle fonctionner si vous devez travailler 10 heures ou plus chaque jour pour simplement survivre ? Quelques heures après l’introduction soudaine du confinement (4)L’annonce du confinement en Inde n’a eu lieu que quelques heures à l’avance. L’arrêt immédiat de tous les moyens de transport public a obligé des centaines de milliers de travailleurs à rentrer « en masse » à pied pendant des heures dans leurs villages, qui se trouvaient parfois à des centaines de kilomètres des villes où ils avaient travaillé jusqu’alors. en Inde, des milliers de chômeurs et de sans-abri indiens supplémentaires se sont retrouvés dans les files des soupes populaires, ne sachant plus où aller.
Dans les pays en développement, le travail informel est de loin la forme la plus courante. En Inde et au Pakistan, 70 % de la population active travaillerait dans le secteur informel. La sécurité sociale est pratiquement inexistante dans les pays du Sud global.
Cela s’explique en partie par l’importance du secteur informel, mais surtout par les énormes remboursements de la dette extérieure qui absorbent jusqu’à 40 % des recettes fiscales de certains pays.
L’impact de la pandémie sur les revenus des personnes et donc sur leur vie quotidienne est donc dramatique.
Une étude de l’Institut mondial de recherche sur l’économie du développement de l’Université des Nations unies (UNU-WIDER) indique que, pour la première fois depuis le début des années 1990, le nombre de personnes tombant sous le seuil de pauvreté (5)Cela s’applique à chacun des trois seuils de pauvreté utilisés par la Banque mondiale : 1,90 $, 3,20 $ et 5,50 $ par jour. augmenterait.
Dans le pire scénario, mais non le moins probable (une baisse de 20 % du revenu moyen), d’ici la fin de 2020, plus de la moitié de la population mondiale tomberait sous le seuil de pauvreté de 5,5 dollars par jour, soit un demi-milliard de personnes (7 % de la population mondiale) de plus qu’avant la pandémie !
Intervention gouvernementale
Selon le rapport « Perspectives économiques mondiales », les gouvernements sont intervenus jusqu’au 12 juin 2020 pour un montant phénoménal de 11.000 milliards de dollars. Cela suffira-t-il pour surmonter cette crise ?
Le montant indiqué par le FMI concerne essentiellement les pertes fiscales directes dues à la baisse de la production et de la consommation et le coût des mesures prises par les gouvernements(6)5 400 milliards de dollars de dépenses publiques supplémentaires et moins de recettes fiscales, et 5 400 milliards de dollars de prêts, garanties et autres opérations quasi budgétaires du gouvernement.. Ces montants n’incluent pas encore les coûts que les gouvernements veulent consacrer à l’une ou l’autre forme de politique de relance.
Comme indiqué ci-dessus, cette pandémie se déroule dans une économie mondiale gravement affaiblie(7)C’est dans ce contexte que nous pouvons placer la liste bizarre aujourd’hui. L’indice S&P500 cote à 26 fois le bénéfice prévu pour 2020 et 20 fois celui de 2021. C’est un quart plus cher que la moyenne historique. (De Tijd, 11/08/2020). Les possibilités d’investissement dans les secteurs productifs qui génèrent des taux de profit élevés sont extrêmement limitées. Cette situation, ainsi que l’argent « gratuit » des banques centrales, stimule les comportements spéculatifs..
L’indice S&P500 enregistre 26 fois le bénéfice prévu pour 2020 et 20 fois celui de 2021. C’est un quart plus cher que la moyenne historique. (De Tijd, 11/08/2020). Les possibilités d’investissement dans les secteurs productifs qui génèrent des taux de profit élevés sont extrêmement limitées. Cette situation, ainsi que l’argent « gratuit » des banques centrales, stimule les comportements spéculatifs.
Les investisseurs achètent principalement des « actions de croissance » (c’est-à-dire des actions d’entreprises dont les bénéfices futurs sont censés valoir la peine, tandis que pour les « actions de valeur », les investisseurs tiennent principalement compte de la valeur actuelle d’une entreprise). L’indice composite du Nasdaq (qui comprend les 100 plus importantes entreprises technologiques, dont Alphabet, Amazon Apple, Baidu, Facebook, Intel, Microsoft, Tesla) est presque 60 % plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était le 20 mars 2020 (le point le pluis bas). En outre, le rapport prix/bénéfices est également complètement faussé aujourd’hui.
Depuis les années 1970, l’économie mondiale est entrée dans une période prolongée de ralentissement de la croissance (Les causes de cette longue période de ralentissement de la croissance sont décrites en détail dans Het Laatkapitalisme (Le capitalisme tardif) d’Ernest Mandel)(8)Ce travail est sans doute l’une des contributions les plus importantes à la théorie économique marxiste. Il fournit une analyse et une explication larges et pénétrantes des développements du mode de production capitaliste au 20e siècle, en particulier dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale..
Jusqu’à présent, toutes les tentatives de transformer cette phase particulièrement longue de ralentissement de la croissance en une phase prolongée de croissance économique accélérée telle que nous l’avons connue après la Seconde Guerre mondiale, ont échoué.
Les recettes keynésiennes appliquées après la Seconde Guerre mondiale ont stagné dans les années 1970 (stagnation de la croissance combinée à une forte inflation). La politique économique (principalement une politique de déréglementation des marchés financiers et du travail et une législation (para-)fiscale plus favorable au capital) qui a été appliquée à partir des années 1980, a culminé, après plusieurs petits avertissements, dans la crise systémique de 2007-2009.
Cette dernière s’est poursuivie jusqu’à ce jour avec une croissance économique moyenne faible. Dans certains pays industrialisés, la Grèce, l’Italie, l’Espagne pour ne citer qu’eux, le PIB réel était encore plus bas ou légèrement plus élevé dix ans après la crise qu’avant.
Les investissements productifs dans les économies occidentales sont restés modestes tout au long de cette période. Pour tenter de les stimuler, les banques centrales d’Europe et des États-Unis ont mené une politique d’assouplissement quantitatif. Toutefois, les facilités de crédit bon marché qui en ont résulté ont principalement servi à enrichir les investisseurs par des réductions de capital et la distribution de dividendes. Cela a augmenté le taux d’endettement et a affecté la solvabilité de nombreuses grandes entreprises internationales.
L’emploi a également été touché(9)Le taux de chômage moyen au cours de la période 1998-2007 était de 4,9 % aux États-Unis, entre 2008 et 2017 il était de 7,0 %, dans les pays de la zone euro il était en moyenne de 9,0 % (1998-2007) et de 10,3 % (2008-2017).. Bien que l’on ait assisté à une reprise de l’emploi ces dernières années, on a constaté une évolution vers des emplois précaires, flexibles et mal rémunérés.
Alors que le capital a été massivement soutenu par des fonds publics, la dette publique des pays industrialisés a atteint des niveaux sans précédent et des économies supplémentaires ont été imposées à la classe ouvrière.
Dans ce contexte de faible croissance économique, de faible taux d’investissement, de détérioration du taux d’endettement des entreprises et des gouvernements, d’emploi précaire et de faible demande de pouvoir d’achat, et d’inégalité croissante des revenus et des richesses, un retournement – après une reprise relativement faible à partir de 2015 – s’est annoncé dans le courant de 2018.
La croissance du PIB mondial et de la production industrielle s’est ralentie, le commerce mondial et la demande de machines, d’équipements et de biens de consommation durables ont chuté.
Tout comme la faillite de Lehman Brothers en 2008 n’a été que le déclencheur et non la cause de la crise systémique de 2008, la pandémie et les mesures mentionnées ci-dessus pour ralentir la propagation du virus sont donc le déclencheur plutôt que la cause de la nouvelle crise.
Ce contexte (d’une économie de marché affaiblie décrit ci-dessus ) augmente la probabilité que cette crise cyclique se transforme en crise systémique.
L’endettement accru des gouvernements du monde entier a directement entraîné une détérioration du système de santé, ce qui a eu pour conséquence que, non seulement dans les pays en développement (voir ci-dessus) mais aussi dans les pays industrialisés, il était initialement impossible de prendre en charge de manière adéquate le nombre croissant de patients atteints de Covid-19. En outre, cela explique également les taux de mortalité initialement élevés dans les maisons de retraite.
Le confinement était donc nécessaire afin de limiter le nombre d’admissions. Ou comme le dit Hans Kluge, directeur européen de l’Organisation mondiale de la santé : « Ce confinement était bien sûr nécessaire pour mettre de l’ordre dans la capacité de nos soins de santé et pour mettre en place un système de recherche des contacts. (De Tijd 8/8/2020).
Mais plus important encore, l’augmentation du taux d’endettement rend beaucoup plus difficile et, à long terme, impossible de prendre des mesures monétaires et budgétaires pour soutenir l’économie de marché en proie à la panique, et encore moins de mener une politique de relance, ou de s’attaquer aux problèmes sanitaires, sociaux (emploi, pensions, etc.) et climatiques.
Dans la logique libérale, une approche différente était-elle possible ? Et y avait-il une autre possibilité que cette intervention massive du gouvernement ?
Dans la plupart des pays industrialisés, beaucoup d’argent public a été dépensé pour les chômeurs (temporaires) et les droits passerelles pour les indépendants dont les entreprises ont dû être provisoirement fermées. C’est normal, ; aurait-il été soutenable que le gouvernement n’intervienne pas ?
Dès le début de la crise sanitaire, il était clair que l’économie de marché, laissée à elle-même, ne pourrait pas supporter les conséquences économiques sans une intervention massive des gouvernements.
Un exemple très simple pour illustrer : un restaurant loue un bâtiment à une société immobilière qui a emprunté à une banque pour construire le bâtiment. Le restaurant est obligé de fermer, ses revenus sont réduits à néant. Si cela continue pendant trop longtemps, les liquidités du propriétaire du restaurant s’épuisent. Le loyer ne peut plus être payé à l’agence immobilière. La société immobilière ne peut plus assurer le remboursement de sa dette à la banque.
Si cela se produit à grande échelle, dans différents secteurs et dans le monde entier comme aujourd’hui, alors les relations socio-économiques entre les travailleurs et les entreprises, entre les entreprises, entre les sociétés de production et les institutions financières, entre les institutions financières, etc. ne peuvent plus être maintenues.
Même les plus grandes et les plus riches entreprises et institutions financières sont entraînées dans le tourbillon et la valeur de leurs actions et autres titres sur les marchés boursiers baisse.
Lorsque la perte de valeur de tous ces titres de propriété privée devient suffisamment importante, le système de production capitaliste lui-même est mis en danger.
En raison de l’absence de chiffre d’affaires, les employé.e.s du restaurant, de l’agence immobilière et même de la banque ne peuvent plus être payé.e.s par les sociétés privées.
Abandonnée aux forces du marché, la perte de revenus de la classe ouvrière serait également gigantesque. En conséquence directe, il y aurait une énorme baisse du pouvoir d’achat et donc de la demande. En outre, des troubles sociaux à grande échelle seraient pratiquement inévitables. Cela augmenterait encore le danger pour le système.
Aucune entreprise, aucun investisseur ou entrepreneur ne pourrait faire face à un choc tel que celui subi aujourd’hui du fait de la pandémie, sans faire appel au gouvernement.
L’intervention du gouvernement est donc tout à fait justifiée ?
Il est absolument nécessaire que les gouvernements interviennent afin de soutenir le pouvoir d’achat de la population. Cela se produirait dans n’importe quel système économique.
Toutefois, les conséquences pour le tissu économique décrites ci-dessus vont au-delà d’une perte de pouvoir d’achat. Toute l’économie est menacée par une réaction en chaîne de faillites, de licenciements, de chômage et de pauvreté. Cela ne se produirait pas dans tous les systèmes, mais cela est inhérent à la manière dont l’économie et la société capitaliste sont organisées, à savoir la propriété privée des moyens de production.
Imaginez une société dans laquelle les principaux actifs ou moyens de production (bâtiments, machines et équipements, etc.) ne sont pas la propriété d’un individu ou d’un groupe d’individus, mais appartiennent à la communauté.
En d’autres termes, une société où la démocratie non seulement politique mais aussi économique est la règle. Dans laquelle il est décidé collectivement ce qui est produit, en quelle quantité et dans quelles circonstances. Une société qui distribue les fruits de la production entre ses membres en fonction de leurs besoins.
Une partie des ressources et de la main-d’œuvre sera alors utilisée pour maintenir les restaurants ouverts, pour autant qu’il existe un besoin social en ce sens. Toutefois, si, par précaution, en cas de pandémie telle que celle que nous connaissons aujourd’hui, les restaurants doivent être fermés temporairement, cela n’aura pas d’autres conséquences sur les propriétaires, les institutions financières, etc. Aucun prêt d’une banque privée n’a été nécessaire pour construire le restaurant, aucun loyer ne doit être payé à qui que ce soit puisque le bâtiment appartient à la communauté.
En outre, tant qu’il sera nécessaire de maintenir les restaurants fermés pour des raisons de santé, il faudra veiller à ce que tous ceux qui y travaillaient avant puissent encore subsister.
Et dans la mesure du possible, le temps de travail libéré pourrait même être utilisé dans les secteurs où les besoins ont augmenté en raison de la situation inhabituelle.
Le principal problème auquel serait confrontée cette société dans le cadre d’un « confinement » similaire (qui n’aurait peut-être pas été nécessaire ou qui l’aurait été dans une mesure plus limitée parce que le système de soins de santé aurait été mieux développé) serait donc de maintenir les services essentiels (soins de santé, éducation, …) et la production (nourriture, infrastructure, …) afin que les besoins essentiels de tous puissent être satisfaits. D’autres questions, telles que le réapprovisionnement de la garde-robe, le renouvellement de certains biens durables, le tourisme, les manifestations culturelles, les visites de restaurants et de cafés, … pourraient être reportées et rétablies progressivement sans causer de dommages supplémentaires aux producteurs et aux prestataires de services concernés.
Aujourd’hui, cela se produit, très partiellement, dans le secteur public. La rémunération des employés du secteur public se poursuit, même s’ils ne peuvent pas (télé)travailler. Si le gouvernement dispose de ses propres bâtiments, de son propre personnel d’entretien et de nettoyage, les coûts sont essentiellement limités aux salaires. Dans cette crise profonde, il apparaît donc que les pays dont le secteur public est le mieux développé résistent le mieux aux effets du confinement et que ce sont surtout les services publics qui continuent à fonctionner sans trop de complications.
Le système de soins de santé hautement privatisé des États-Unis le démontre de manière particulièrement frappante : selon le Bureau des statistiques du travail, 43 000 emplois ont été perdus dans le secteur des soins de santé : en raison des licenciements massifs au cours desquels les personnes ont également perdu leur assurance maladie et de la suspension des rendez-vous médicaux non urgents, le chiffre d’affaires et les bénéfices des hôpitaux ont chuté de manière drastique, avec pour résultat incroyable le licenciement du personnel médical. Le seul hôpital du comté de Marion, en Virginie occidentale, a fermé à la fin du mois de mars. Quelques jours plus tard, le premier patient Covid-19 de Virginie occidentale est mort dans ce comté.
Mais toutes les interventions publiques ne se font pas dans l’intérêt de la majorité de la population, loin de là… Peux-tu expliquer quel type d’intervention gouvernementale est particulièrement « socialement nocif » ?
Le fait est que, dans la logique de l’économie de marché, l’objectif des interventions gouvernementales n’est pas de maintenir (et encore moins d’améliorer) les conditions de vie et de travail de la population, mais de maintenir les rapports de production inhérents au mode de production capitaliste. Cela explique pourquoi les énormes coûts supplémentaires de chaque crise, y compris celle-ci, sont répercutés sur la société, « socialisés » afin de garantir les profits des capitalistes.
Une évaluation correcte du rôle joué par l’État dans la société est cruciale pour comprendre les mesures prises aujourd’hui. L’État n’est pas et ne peut pas être une institution qui se tient au-dessus des contradictions sociales.
Tant qu’il existera différentes classes dans une société (c’est-à-dire des groupes de personnes ayant des positions et des intérêts sociaux et économiques fondamentalement différents) où une classe domine politiquement et économiquement, il faudra un « État » dont la tâche sera de protéger l’ordre établi au nom de cette classe.
Afin de maintenir l’ordre social et les relations de classe existantes, l’État doit être en mesure de remplir certaines fonctions essentielles :
– La fonction répressive, qui doit protéger le mode de production existant (ordre social) contre la menace des classes dominées ou de certains membres des classes dominantes (armée, police, justice).
– La fonction intégrative permet que la structure de classe ne soit pas constamment remise en question par la classe dominée, de sorte qu’une répression permanente n’est pas nécessaire pour sa soumission à la domination de classe. Le gouvernement joue un rôle important dans ce domaine en fournissant des équipements pour l’éducation, la formation, la culture et les médias de masse.
– Créer des conditions générales de production qui ne peuvent être garanties par les membres individuels de la classe dirigeante.
Il existe des conditions techniques générales (construction et entretien des routes, infrastructures portuaires, aéroports, …) et des conditions sociales générales (par exemple, système de monnaie stable, sécurité (juridique) pour un marché intérieur, sécurité et conditions juridiques, réglementations économiques, …).
La caractéristique du capitalisme actuel est que les grands monopoles sont obligés de compter de plus en plus sur l’intervention directe ou indirecte de l’État pour atteindre leurs objectifs de profit, et même pour leur survie. De cette manière, le gouvernement crée d’importantes possibilités de réaliser des investissements, garantit des profits lorsque les choses vont mal et se porte garant pour la couverture des pertes.
Quelques exemples pour l’illustrer
La réaction des banques centrales à la chute spectaculaire des cours boursiers (de fin février à mi-mars) en est un exemple éloquent : le 27 février, Christine Lagarde, la toute nouvelle présidente de la BCE, a déclaré qu' »une intervention monétaire n’était pas immédiatement évidente ». Le 2 mars, la FED réduit son taux directeur de 0,5 point de pourcentage, la banque centrale australienne de 0,25 point de pourcentage et Christina Lagarde, au nom de la BCE, promet de « prendre les mesures appropriées ».
Les investisseurs considèrent clairement que cela est insuffisant. Environ un mois après le début de la tendance à la baisse, les actions dans la plupart des bourses ont perdu 30 à 38 % de leur valeur.
Du coup les robinets d’argent se sont réellement ouverts : le 12 mars, la FED a injecté 1 500 milliards de dollars sur le marché monétaire ; le 18 mars, la BCE a annoncé qu’elle allait acheter 750 milliards d’euros d’obligations supplémentaires aux gouvernements et au secteur privé ; d’autres grandes banques centrales prennent des mesures similaires pendant cette période. Outre la recette classique consistant à abaisser le taux de base, les réserves de capitaux et de liquidités des banques seront également réduites temporairement, lorsque cela est encore possible, et des facilités de crédit bon marché seront accordées aux établissements financiers.
Les bourses entament alors une remontée, car une fois de plus, les gouvernements sont prêts à sauver les entreprises d’une manière qui n’affecte pas les droits de propriété des investisseurs.
Un exemple connexe : les gouvernements des pays de la zone euro ne peuvent pas obtenir d’argent directement de la BCE, ils doivent se tourner vers les institutions financières privées. De cette manière, les dettes publiques qui sont massivement contractées aujourd’hui sont une source importante de profit pour les banques.
Mais les banques européennes reçoivent de l’argent de la BCE. À la mi-juin, elles avaient déjà emprunté 1 308 milliards d’euros à la Banque centrale européenne (BCE) à un taux d’intérêt de -0,5 à -1%. Elles empruntent donc 1 308 milliards d’euros et reçoivent jusqu’à 1 % d’intérêt chaque année (tant que le prêt dure), soit 13,08 milliards d’euros. Elles peuvent ensuite utiliser ces fonds pour accorder des prêts aux entreprises, aux citoyens et aux … autorités publiques, à des taux positifs bien sûr.
Mais même quand les banques européennes ne prêtent pas l’argent à la BCE, elles en gagnent dessus. Le 1% qu’ils reçoivent chaque année, ils peuvent aussi « le garer » à la BCE, pour laquelle elles ne paient que 0,5%.
Qui paie pour ce cadeau ? Eh bien, la BCE et les banques centrales des pays de l’euro font moins de bénéfices donc en fin de compte, cela signifie moins de revenus pour les gouvernements.
Un troisième exemple : le groupe Lufthansa a vu son chiffre d’affaires diminuer de moitié et a enregistré une perte nette de 3,6 milliards d’euros au cours du 1er semestre 2020. Le président Karl-Ludwig Kley a déclaré sans équivoque que sans le soutien d’un milliard de dollars, la société serait confrontée à la faillite. Chez Brussels Airlines, le chiffre d’affaires a chuté de 63 % sur la même période et la compagnie a enregistré une perte (avant déduction des intérêts et des impôts, EBIT) de 211 millions d’euros.
Ils frappent donc à la porte du gouvernement pour obtenir de l’argent. L’État allemand accorde à la société mère de Brussels Airlines un crédit de 3 milliards d’euros et prend une participation tacite de 5,7 milliards d’euros sans droit de vote(10)Heinz Hermann Thiele, dont les actifs sont estimés à 10 milliards d’euros, est l’un des principaux actionnaires de Lufthansa et n’est pas satisfait de l’accord. Selon lui, en échange des 9 milliards d’aide et d’une participation de 20 %, le gouvernement aura « trop à dire ».. Pendant ce temps, le groupe travaille sur le programme de restructuration « ReNew » qui prévoit une réduction de 22 000 emplois à temps plein.
Le gouvernement belge accorde à Brussels Airlines un prêt de 290 millions d’euros alors que Lufthansa elle-même ne met que 170 millions d’euros (c’est-à-dire l’argent du gouvernement allemand) dans sa filiale. Sur ce montant, 70 millions d’euros seront consacrés au plan de restructuration, plus de 1 000 des 4 000 emplois disparaissant.
Des accords similaires ont été conclus avec Air France-KLM, qui recevra une aide de 7 milliards d’euros du gouvernement français et de 3,4 milliards d’euros du gouvernement néerlandais. Ces gouvernements ne prennent même pas une seule participation au capital. Toutefois, certaines exigences minimales en matière de climat ont été fixées et, une fois de plus, un plan de restructuration a été élaboré.
Alitalia recevrait une aide de 3 milliards d’euros du gouvernement italien. Or la mauvaise santé de la compagnie italienne n’est pas seulement due à la fermeture des frontières, aux interdictions de voyager ou aux vols annulés. La société est déficitaire depuis de nombreuses années.
Autre exemple : les gouvernements de divers États des États-Unis accordent des « crédits régulateurs » gratuits aux entreprises (entre autres) en fonction du nombre de VEZ (véhicules à émissions zéro) qu’elles produisent. Ce n’est qu’en vendant ces certificats à d’autres constructeurs automobiles que Tesla (qui ne produit que des ZEV) peut réaliser des bénéfices (voir également la note de bas de page 7).
Il doit être clair que ni les besoins du personnel, ni le climat, ni les besoins de transport ne sont au centre de tout cela. Ce qui importe, c’est que les grandes entreprises privées puissent survivre et que le capital et les droits de décision des détenteurs de capitaux soient préservés lorsqu’ils sont touchés par une crise, ou du moins lorsqu’il y a une menace de crise. Les coûts sont à la charge de la collectivité.
De nombreux exemples peuvent encore être cités.
Une politique keynésienne ?
Jusqu’à présent, le gouvernement est intervenu principalement pour limiter l’impact économique immédiat de la pandémie et pour la combattre. Mais entre-temps, divers partis, organisations patronales, syndicats, groupes de réflexion, mais aussi des institutions gouvernementales impliquées dans la programmation économique (banques centrales, bureaux du plan, etc.) proposent des idées pour une politique de relance économique.
N’y aurait-t-il plus de « néo-libéraux » pour s’opposer à l’ingérence du gouvernement dans l’économie et le temps serait-il revenu pour à nouveau mener une politique keynésienne de relance économique, comme dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ?
Il est vrai qu’aujourd’hui, il n’y a presque plus de politiciens, d’économistes, de chefs d’entreprise, … qui soutiennent que les déficits et les dettes publiques doivent être traités de toute urgence.
Même après la phase de « confinement » – dans laquelle se trouvent encore tous les pays ( exception faite de la Chine) – on attend généralement du gouvernement qu’il intervienne davantage dans l’économie, qu’il s’investisse lui-même et qu’il prenne des mesures qui encouragent l’investissement privé. Et on ressort Keynes de son tiroir idéologique.
Il y a un certain nombre de commentaires importants à faire ici.
Premièrement, il y a une différence entre la rhétorique idéologique et la politique économique réelle. Dans la phase de déclin du capitalisme tardif des années 1970 à nos jours, le gouvernement a continué à jouer un rôle économique important, même sous les gouvernements « néolibéraux » les plus enragés comme Thatcher et Reagan. La moyenne des dépenses publiques aux États-Unis sous Reagan (1981-1989) était de 34,6 % du PIB. Dans les années de pointe de la politique keynésienne (1961-1969), ce chiffre ne représentait « que » 29,7 % du PIB.
En d’autres termes, une plus grande partie de la richesse produite annuellement sous Reagan est allée au gouvernement que dans les années 1960, années « dorées » du Keynésianisme.
Mais en regardant de plus près ce qui s’est passé sous Reagan, on constate une « redistribution inversée » de l’intervention de l’État. Directement, en soulageant les revenus du capital, et indirectement, en sapant davantage l’équilibre social du pouvoir de la classe ouvrière par rapport à la classe capitaliste – qui avait déjà été gravement touchée par la récession des années 1970 et la tendance à la mondialisation du capital – entre autres par une déréglementation sévère de la législation du travail et une libéralisation poussée des marchés financiers. Cette politique gouvernementale a été plus ou moins adoptée dans les autres pays industrialisés à partir des années 1980. En Europe, cela s’est souvent accompagné de la privatisation des services publics.
Cependant, soulignons que la rhétorique keynésienne diffère également de la politique menée par ses partisans. Cela est particulièrement clair lorsque l’on considère l’attitude sociale-démocrate : dans la période après 1980, la social-démocratie (qui est idéologiquement favorable à la politique économique keynésienne(11)La social-démocratie s’est éloignée de la théorie économique marxiste depuis la fin du XIXe siècle, d’abord de facto, mais très peu de temps après aussi théoriquement., a contribué,lorsqu’elle était au gouvernement, à une politique de redistribution inversée au détriment de la classe ouvrière.
C’est le cas des réformes Hartz sous Schröder en Allemagne(12)e.a. avec l’introduction des mini-emplois où les travailleurs peu qualifiés sont récompensés à 450€ par mois (ou moins). En 2009, près de 5 millions de travailleurs allemands occupaient une sorte de mini-emploi. Ou avec la réduction drastique des allocations de chômage dans « Hartz IV »., des mesures d’austérité et de désinvestissement du gouvernement en Grèce après 2008 par un gouvernement social-démocrate du PASOK(13)Un gouvernement du PASOK en 2010, suivi d’un gouvernement du PASOK et d’un gouvernement libéral en 2011, ont signé respectivement le premier et le deuxième programme d’ajustement économique avec une réduction drastique des salaires nominaux et des pensions des fonctionnaires, une augmentation de la TVA (une taxe régressive affectant principalement les revenus les plus faibles), des économies dans l’investissement public, la privatisation des services publics, de l’aéroport national, du port du Pirée et de Thessalonique, la vente de bâtiments publics, etc., ou des mesures d’austérité introduites dans notre pays sous le gouvernement Di Rupo (2011-2014).
Ce dernier a par exemple diminué les cotisations sociales des employeurs tout en économisant chaque année plusieurs milliards dans les allocations de chômage, les (pré)pensions, les soins de santé, le personnel et les ressources des services publics fédéraux et les entreprises publiques, etc(14)Pour les détails pertinents, voir entre autres le « Projet de déclaration de politique générale » du 1er décembre 2011..
En clair, les politiques économiques menées par ces gouvernements dépendaient moins de l' »idéologie » que des besoins réels de la classe capitaliste dominante. Et, comme indiqué précédemment, elles sont aujourd’hui complètement différentes de celles de la phase d’expansion de la fin de la période capitaliste après la Seconde Guerre mondiale.
Deuxièmement, une politique de relance consiste essentiellement en la création par le gouvernement d’un pouvoir d’achat supplémentaire qui doit absorber un manque de demande par le marché.
Il existe différentes façons de le faire :
Le gouvernement peut stimuler la consommation de certains biens par le biais d’une forme de subvention. En France, par exemple, le gouvernement a décidé fin mai d’augmenter de 8 milliards d’euros les subventions pour l’achat d’une voiture dans le cadre d’un plan de soutien au secteur automobile.
Elle peut également être réalisée par des investissements publics qui permettent de réduire indirectement les coûts d’exploitation : par exemple, en construisant davantage d’infrastructures routières pour réduire les coûts de transport, en investissant dans le système de santé pour réduire les coûts de santé, en investissant de manière ciblée dans l’éducation pour réduire les coûts de formation des entreprises, etc(15)Voir par exemple la lettre ouverte de 32 « capitaines d’industrie » concernant les objectifs à atteindre dans l’enseignement secondaire. À cet égard, ils plaident en faveur de « 4 corrections » qui « mettent davantage l’accent sur les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) en tant que partie importante du développement des talents sur le marché du travail et dans la politique économique flamande ». En Flandre, la ministre de l’économie Hilde Crevits (CD&V) a décidé de dépenser 90 millions d’euros au cours des quatre prochaines années pour « stimuler l’esprit d’entreprise et l’innovation en Flandre ». L’argent va à Unizo, Voka et Agoria, entre autres (De Tijd, 27/6/2020)..
C’est principalement de ces deux manières que la plupart des partis, des organisations patronales, des groupes de réflexion et des institutions gouvernementales souhaitent une politique de relance. Dans de nombreux cas, cela va alors de pair avec une restriction des dépenses publiques en matière de sécurité sociale, des propositions d’allongement du temps de travail, une plus grande flexibilisation – adaptée à l’employeur – du marché du travail et une limitation des coûts salariaux (limitation des salaires bruts et/ou réduction des cotisations de sécurité sociale des employeurs)(16)Voir par exemple les plans de relance de VOKA (https://www.voka.be/relance) et du VBO (https://www.vbo.be/newsletters/pb-2020.06.26-focus-conjunctuur-van-het-vbo-coronacrisis-slaat-diepe-krater-in-welvaart.-relanceplan-nodig/-corona crisis-slaat-deep-crater-in-welvaart.-relanceplan-necessary/.
Nous ne devons donc pas assimiler la poursuite d’une politique de relance (keynésienne) au soutien du pouvoir d’achat de la classe ouvrière, bien au contraire.
En principe, le gouvernement pourrait également augmenter les dépenses de consommation : rendre les prestations sociales (en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, …) vivables, augmenter les pensions, augmenter les salaires (minimum).
Le plan de relance du PS belge comprend également des propositions visant à augmenter le pouvoir d’achat des revenus les plus faibles afin de soutenir la demande intérieure et donc la croissance(17)Généralement en termes assez vagues : « Développer une grande campagne européenne contre la pauvreté, pour combattre les effets directs de la crise sur les groupes les plus vulnérables ». … « Relever toutes les prestations sociales au-dessus du seuil de pauvreté » « Mettre en place des contributions spéciales pour assurer le financement durable de l’État et de la sécurité sociale sans affecter le pouvoir d’achat des ménages », etc..
Mais c’est précisément cette façon de stimuler une demande de pouvoir d’achat qui est critiquée de toutes parts(18)La proposition du PS a été critiquée dans les médias, par d’autres partis politiques (voir par exemple la polémique entre Paul Magnette et Johan Vanovertveldt dans De Tijd au début du mois de juin 2020), ainsi que par Paul De Grauwe qui qualifie le plan de « surréaliste ». D’autre part, les organisations patronales plaident pour une réduction des coûts salariaux..
Et ce n’est pas surprenant : une amélioration permanente des salaires et des prestations sociales qui ne suivrait pas une augmentation de la productivité signifierait qu’il y a une redistribution structurelle des revenus en faveur des salariés et des bénéficiaires de prestations et au détriment des revenus du capital, ce qui affecte davantage le taux de profit à long terme.
Cela va à l’encontre de la logique du capitalisme lui-même et nécessite un rapport de force et l’organisation d’une résistance militante contre le pouvoir de décision du capital(19)Cela s’applique également aux investissements productifs du gouvernement. En effet, le gouvernement lui-même pourrait produire certains biens par la création d’entreprises publiques et ainsi créer des emplois et fournir des biens et des services. Ce n’est cependant pas un hasard si un mouvement inverse – c’est-à-dire la privatisation des entreprises publiques (compagnies de téléphone, compagnies aériennes, banques publiques, production d’électricité, transports publics, etc..
Une autre préoccupation concerne les chances de succès d’un plan de relance. Comme indiqué ci-dessus, la pandémie Corona se produit dans le contexte d’une économie capitaliste tardive extrêmement fragile. En conséquence, la crise socio-économique est particulièrement grave.
L’État ne peut pas créer un pouvoir d’achat supplémentaire illimité et plus la récession est importante, plus le gouvernement doit créer un pouvoir d’achat supplémentaire pour avoir un effet.
Les chances qu’avec les énormes déficits publics et les dettes déjà accumulés jusqu’à présent, le gouvernement (même avec le soutien de l’Europe) puisse remettre l’économie capitaliste sur la voie de la croissance à long terme pendant plusieurs années sont très faibles. Aussi parce que ce soutien empêche l’effet « salutaire » d’une crise du capitalisme – la restauration des taux de profit par la dévaluation/élimination du peu ou manque de capitaux rentables.
Une quatrième préoccupation concerne la contradiction entre une politique de relance et la lutte contre le changement climatique.
Le capitalisme perd son dynamisme lorsque la production et la consommation de biens ne continuent pas à augmenter. Là encore, la logique du capitalisme est perverse : l’économie ne sert pas à répondre aux besoins matériels des gens. Les gens doivent travailler et acheter pour assurer les profits du capital, si cela ne se produit pas ou si cela se produit trop peu, alors la production s’arrête, l’emploi diminue et nous nous retrouvons dans une crise économique.
L’objectif d’une politique de relance est donc de stimuler la production et la consommation de biens.
Malgré toute la rhétorique sur les investissements « respectueux du climat », cela signifie recommencer à produire plus de voitures(20)L’exemple de la France donné ci-dessus est révélateur, mais l’Allemagne veut aussi soutenir l’industrie automobile., fabriquer/produire plus d’appareils électroniques (des smartphones aux téléviseurs), prendre davantage l’avion (les compagnies aériennes et le secteur du tourisme doivent également être « sauvés »), et ainsi de suite. Produire plus implique une plus grande consommation d’énergie, davantage d’émissions de CO2 et, en fin de compte, un réchauffement climatique plus important(21)Avec cela, nous ne voulons pas prétendre qu’il n’y aurait pas de pénurie matérielle. Les conditions de vie extrêmement précaires de la majorité de la population mondiale montrent le contraire. Mais en même temps, les personnes les plus aisées (principalement dans les pays industrialisés) sont encouragées à consommer des biens qui n’améliorent que légèrement, voire pas du tout, leur qualité de vie et parfois même la détériorent (cigarettes, consommation excessive d’alcool et de nourriture, achat d’un nouveau smartphone chaque année pour « être avec », etc.) .
Oser regarder au-delà de l’horizon du capitalisme
Si une politique de résurrection keynésienne n’est pas la solution, alorsquelle alternative ?
Comme nous l’avons dit, cette crise met une fois de plus, et plus clairement qu’auparavant, en évidence l’impuissance d’une économie de marché à répondre aux principaux besoins de la société.
Une fois de plus, le gouvernement doit sauver le système économique à tout prix. Tôt ou tard, le coût sera répercuté sur la classe ouvrière.
En outre, le changement climatique exige un examen urgent à la fois de ce qui est produit et de la manière dont il l’est. Or c’est par définition incompatible avec une dynamique capitaliste axée uniquement sur le profit.
Pour ces deux raisons, nous devons oser regarder en dehors du cadre capitaliste afin de mettre en œuvre de véritables solutions.
Compte tenu de la situation socio-économique et politique actuelle, deux étapes importantes me semblent indispensables, :
Tout d’abord, un moratoire sur le remboursement des dettes et l’annulation des dettes illégitimes.
Pour les pays en développement, l’annulation de la dette est un problème aigu. Les experts affirment sans équivoque que les pays en développement sont confrontés au choix de rembourser les créanciers étrangers ou d’empêcher (encore plus) d’habitants de mourir.
Mais la dette irresponsable doit également être remise en question dans les pays industrialisés.
Il y a des dettes qui ont été contractées en violation du droit national ou international. Il existe des dettes qui ont été contractées dans des conditions déraisonnables et répréhensibles, qui sont contraires à l’intérêt général ou qui impliquent la conversion de dettes privées en dettes publiques. Il y a aussi des dettes résultant de décisions non démocratiques.
Dans tous ces cas, une annulation est nécessaire. En outre, une suspension temporaire est requise pour le paiement de dettes non viables.
Il s’agit de dettes qui, bien que justifiées, ne permettent pas au gouvernement d’un pays de garantir les droits fondamentaux de l’homme tels que l’alimentation, l’éducation, les soins de santé, les services publics, …
L’enquête sur les dettes irresponsables et insoutenables doit être menée de manière démocratique et non à huis clos. La population a le droit de participer, par l’intermédiaire des organisations de la société civile et directement, tant au processus d’enquête qu’à la détermination du résultat d’un audit de la dette.
Deuxièmement, un impôt substantiel, progressif et exceptionnel sur la fortune des 10 % les plus riches.
Son apport ne devrait pas seulement servir à payer la facture du déficit public prévu pour 2020 (33-39 milliards d’euros). L’intention d’un impôt exceptionnel sur la fortune devrait être plus ambitieuse et inclure notamment les objectifs suivants :
– Réduire drastiquement la dette publique jusqu’à ce que nous puissions revenir au taux de 2007, c’est-à-dire le taux d’endettement des interventions massives du gouvernement qui avaient pour but de sauver les institutions financières d’un fiasco dû à des investissements spéculatifs inconsidérés.
– Financement des investissements publics et des mesures visant à assurer un emploi suffisant, avec des salaires et des conditions de travail décentes pour tous et toutes.
– Développer les services publics qui protègent les personnes, la société et l’environnement contre la pauvreté, la discrimination et la pollution.
Cela signifie que les rendements doivent être suffisamment importants pour atteindre ces objectifs.
Avant le déclenchement de la pandémie, nous avions développé l’exemple d’un impôt sur la fortune. Avec des taux d’imposition progressifs sur la fortune nette – de 1 % pour le 91e centile à 16 % pour le 100e centile (le 1 % le plus riche) – et une déduction de 500 000 euros pour son propre logement.
Calculé sur la base de l’actif net des ménages en 2018, le produit de l’impôt sur la fortune pour l’année 2018 pourrait être estimé à un peu plus de 100 milliards, soit un peu plus de 20 % du PIB.
Cette contribution unique n’est pas une expropriation. En moyenne, la richesse des 10 % les plus riches ne diminue que de 7 à 8 %. Mais avec ce montant, la société peut développer ses propres initiatives qui répondent aux objectifs mentionnés ci-dessus sans être dépendante du marché des capitaux privés.
Il doit être clair qu’une telle proposition nécessite la volonté politique d’imposer un « cadastre des fortunes » et ne sera jamais obtenue sans lutte. Car les opposants à un impôt sur la fortune remettent rarement en question l’utilité ou l’équité d’un impôt sur la fortune : ils invoquent généralement l' »infaisabilité technique ».
Tous ceux qui sont professionnellement impliqués dans la fiscalité le savent : les systèmes fiscaux sont toujours complexes. L’élaboration de règles, de procédures d’enregistrement, de contrôle et de recouvrement exige toujours une réflexion préalable sérieuse des fonctionnaires compétents. C’est le cas pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de l’impôt sur les sociétés, de la TVA, etc.
Il n’est pas plus facile (ni plus difficile!) de mettre en place un impôt efficace sur la fortune que pour d’autres types d’impôts, à condition que les autorités fiscales aient accès aux données nécessaires. Tout comme elle a actuellement accès à toutes les données relatives aux revenus des salariés, des retraités, des chômeurs, des malades, des handicapés, etc.
Grâce à la numérisation avancée, il est maintenant possible de surveiller facilement tous les flux de capitaux. Le secret bancaire de facto doit être complètement levé et un registre des actifs est nécessaire. En utilisant la technologie informatique existante, c’est même relativement facile.
La principale difficulté n’est donc pas d’ordre technique mais réside dans la résistance des riches eux-mêmes à renoncer leur emprise sur les événements économiques et politiques.
Il appartient aux organisations de la société civile et aux forces politiques de gauche de donner forme à cette alternative, de construire les rapports de force nécessaire et de créer un soutien social et politique suffisant pour la levée complète du secret bancaire, l’introduction d’un cadastre des fortunes et d’un impôt spécial de crise sur le grand capital.
Notes