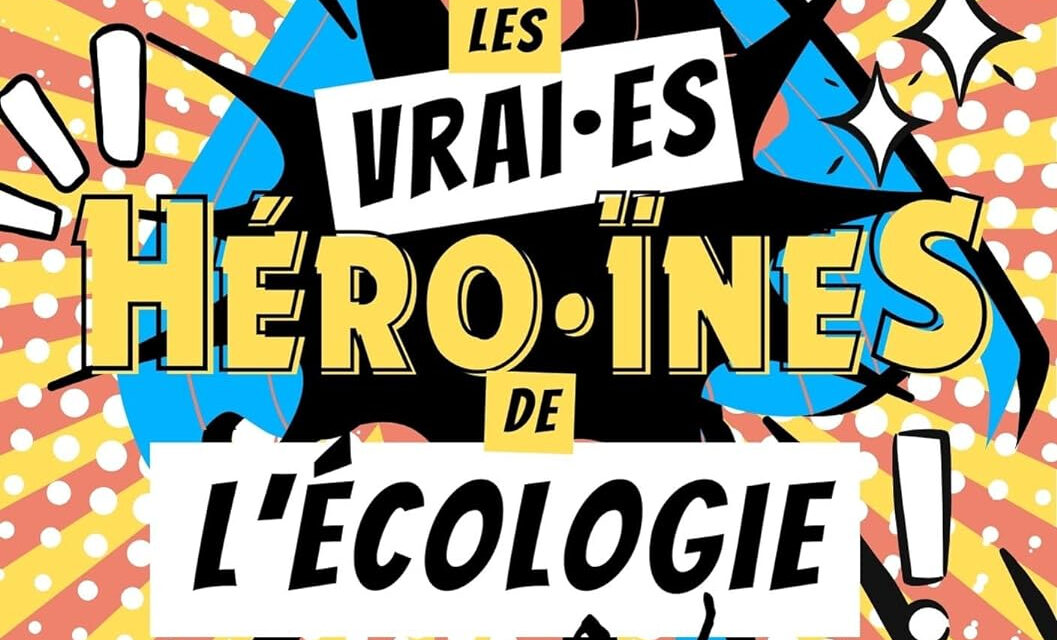Dans cet ouvrage incisif et percutant, Esmeralda Wirtz dresse le bilan cruel d’une écologie qui n’a jamais su, car jamais voulu, s’adresser aux classes populaires. Elle-même activiste environnementale qui s’est notamment fait connaître lors des inondations qui ont frappé sa région de Verviers, elle se propose de présenter un « petit guide pour s’engager de manière radicale et résiliente », aux côtés des « vrai∙es héro∙ïnes de l’écologie » : les classes populaires, les femmes et minorités de genre, les personnes racisées, les peuples du Sud et indigènes. Avec, en ligne de mire, une « révolution anticapitaliste et décoloniale » : un projet auquel on ne peut évidemment que souscrire, mais qui manque encore, peut-être, d’une stratégie bien définie pour le réaliser.
Un bilan de l’écologie mainstream
Dès le premier chapitre, le constat est fait : le discours écologique dominant, à base de petits gestes « pour sauver la planète », n’a jamais pris dans les classes populaires. Pourquoi ? Selon l’hypothèse communément admise, il faudrait mieux sensibiliser, prendre le temps d’expliquer, comme à des enfants qui ne comprendraient que grâce aux vertus de la répétition. L’autrice tente une autre hypothèse : et si ce discours n’était tout simplement pas fait pour elles ?
Car en matière de petits gestes, elles n’ont pas à rougir : les élites branchées qui roulent en voiture électrique, évitent de prendre l’avion pour leurs vacances au ski et ne chauffent qu’à 19°C leur maison à quatre façades ont bel et bien, quelle que soit la sincérité de leur démarche, un impact environnemental largement plus élevé que les habitant∙es de quartiers populaires ou que les peuples du Sud global. Oui, mais voilà : ce sont ces élites qui élaborent les discours écologistes, au moins autant pour définir un style de vie qui les valorisent que pour avoir une action concrète. Et comme tout style de vie qui se propose de mettre en valeur un certain groupe social, il n’a pas été pensé pour inclure les groupes subalternes, mais au contraire pour les exclure. D’autant que la finalité ne convainc pas tout le monde : pour vouloir « s’assurer que [ses] enfants aient la même qualité de vie » que soi, il faut être soi-même satisfait∙e de cette qualité de vie. D’où la nécessité, pour l’autrice, de faire table rase, et de redéfinir un projet écologique centré sur les « vulnérabilisé∙es » – les exploité∙es et les opprimé∙es, aurions-nous dit.
Ce premier chapitre fait apparaître un premier angle mort : alors que l’écologie mainstream des petits gestes est largement décortiquée, sa traduction politique, l’écologie libérale des partis verts, n’est jamais mentionnée. Il y aurait pourtant beaucoup à dire : historiquement ancrés dans les classes moyennes supérieures urbaines, les partis comme Groen et Ecolo ont largement contribué à façonner cette écologie mainstream et l’image que les classes populaires en ont. Or, il est évidemment difficile d’accorder du crédit à une « écologie » qui, lorsqu’elle est au pouvoir, construit des centrales au gaz fossile, valide l’extension de l’aéroport de Liège et cache sous le tapis le scandale des PFAS ; et ne parlons même pas de la capacité de ces partis à construire un projet politique centré sur les « vulnérabilisé∙es », eux qui votaient encore, quelques jours avant l’écriture de ces lignes, un projet de loi qui renforce les compétences de Frontex, l’agence paramilitaire qui est responsable de la mort de plusieurs milliers de migrant∙es dans la Mer méditerranée. (1)À propos du Pacte migratoire européen, dont ce vote est une transposition dans le droit belge, lire Vottem, 25 ans déjà, je ne l’accepte toujours pas !
Vers un projet radical
Le deuxième chapitre développe ce qui doit fonder ce nouveau projet politique : la justice environnementale. Il faut dire que la notion est à la mode : récemment encore, j’ai personnellement assisté à une conférence sur le thème « populations précaires et dérèglement climatique » où deux intervenant∙es avaient préparé des présentations quasiment identiques, toutes deux articulées autour de ce concept, et en détaillant les mêmes grands principes. Reste que si elle est petit à petit digérée et vidée de son sens par les théoricien∙nes de l’écologie libérale, la notion a, à l’origine, le mérite de poser les bonnes questions : qui est responsable des destructions environnementales ? Qui en subit les conséquences ? Et qui aura du mal à s’adapter aux changements qu’elles impliquent ? Sans surprise, la réponse à ces questions est souvent la même. On pourrait cependant en ajouter une quatrième : qui décide des politiques menées ? La lecture d’Esmeralda Wirtz, très fine en termes de privilèges, tend parfois à perdre de vue la question du pouvoir, qui n’est pas entre les mains des écolos blanc∙hes branché∙es des centre-villes – mais entre celles d’une véritable classe sociale, bien plus restreinte et bien plus privilégiée encore.
Le troisième chapitre aborde la question de la nécessaire radicalité d’un projet qui pourrait satisfaire ce principe, en revenant à l’étymologie : est radical un projet qui s’attaque à la racine du problème. L’autrice fait alors un tour d’horizons des théories écologiques qui, si elles se donnent parfois les apparences de la radicalité, n’ont en réalité pas cette qualité : la collapsologie, qui réduit les destructions écologiques à un effondrement monolithique, nécessairement vécu par tou∙tes de la même manière ; le colonialisme vert, qui utilise le Sud global comme réserve à ressources, et nie la capacité des peuples indigènes à prendre soin de leur environnement ; le néo-malthusianisme, qui voit dans la « surpopulation » une bombe climatique, sans voir que seule une minorité est réellement responsable des destructions constatées ; ou encore l’éco-féminisme culturel, qui lie la défense de la nature à celle d’une féminité essentialisée, presque ésotérique, oubliant que le genre est une construction sociale.
À ces courants, l’activiste oppose quelques idées qui pourraient selon elle structurer une écologie radicale : l’économie sociale et solidaire, la lutte contre les discriminations, la défense des libertés, et les valeurs d’empathie et de créativité. Elle en déduit que le changement à opérer est profond, donc d’ordre culturel, ce qui ne manquera pas de faire tiquer les défenseur∙ses des grands principes marxistes : les changements économiques sont-ils conséquences de changements culturels, ou est-ce l’inverse ? Élaborer sur le sujet nous ferait probablement déborder du cadre de ces notes de lecture.
Tactiques et stratégies
Dans le quatrième chapitre, l’autrice aborde la question des moyens : pour elle, le changement passe par des « initiatives comme les potagers collectifs, frigos solidaires, supermarchés coopératifs, lieux autogérés, composts collectifs, parcs éoliens citoyens, monnaies locales, repair-cafés et autres ». Elle montre en quoi chacun de ces projets locaux, libérés des logiques de profit, peut constituer un embryon de société différente. Consciente qu’ils n’agissent cependant qu’à toute petite échelle, elle explore les outils qui permettraient de « mainstreamer les niches ». Dans le sillage de Fatima Ouassak, l’autrice de Pour une écologie pirate et fondatrice d’une « maison d’écologie populaire » dans une cité de Bagnolet, qu’elle cite abondamment, Esmeralda Wirtz met l’accent sur la nécessité pour ces projets de s’implanter au cœur des quartiers, avec la préoccupation permanente d’être adaptés au plus grand nombre. Ce qui soulève un risque inhérent à toute initiative de ce type : celui de s’enfermer dans une logique de bulles, qui s’efforcent d’être les plus inclusives possibles, mais perdent du même coup de vue l’objectif de transformer le monde extérieur. Or, ce n’est pas la multiplication de projets locaux qui entraînera la nécessaire transformation, par exemple, du réseau de transports, qui doit se penser au minimum à l’échelle nationale… Et même les potagers citoyens qui permettent à des centaines de consommateur∙rices de s’affranchir, en partie au moins, de l’agrobusiness, ne sont tolérés que dans la mesure où ils ne concernent, justement, que quelques centaines de personnes par-ci par-là : les capitalistes ont largement les moyens d’écraser ces initiatives si elles venaient à les concurrencer plus sérieusement.
Esmeralda Wirtz a conscience de ces limites. Résolument écosocialiste, elle constate que « construire un monde différent » va de pair avec s’attaquer au monde existant, et opérer un renversement d’ordre politique, ce qui ne peut pas se faire de manière douce : « ce dont nous avons besoin, ce sont les mouvements sociaux. C’est l’activisme. » On relèvera l’équivalence troublante dessinée entre mouvements sociaux et activisme, les premiers semblant réduits au deuxième, qui n’est pourtant qu’une forme très spécifique de l’action collective, par définition réduite à de petits groupes de militant∙es quasi-professionnel∙les. Et cela se confirme quand elle détaille des exemples de modes d’action : « Il peut s’agir d’une combinaison entre les initiatives ‘de niche’ exposées au début du chapitre, de changements dans l’éducation, d’actions et de manifestations de rue, d’actions en justice, de changements de récits, de créations artistiques, et bien plus. » On espère que le bien plus couvre aussi les mouvements de masse – nous y reviendrons.
En attendant, le reste du chapitre se concentre sur un autre débat, très vivant dans le milieu activiste environnemental : celui de la violence et du sabotage. Balayant en bloc les arguments qui qualifient de « violents » certains modes d’actions du mouvement climat, elle rappelle trois fondamentaux sur le sujet : premièrement, la pire des violences réside dans le laisser-faire, qui menace les droits et la vie de milliards de personnes. Deuxièmement, l’urgence est bien trop grande pour s’imposer de jouer dans les règles imposées par nos adversaires. Troisièmement, les États que nous avons en face de nous n’ont pas grand-chose de démocratique, dans la mesure où chaque fois que les citoyen∙nes ont eu l’occasion de d’élaborer elleux-mêmes les politiques qu’iels souhaitaient voir menées (elle cite l’exemple édifiant de la Convention citoyenne pour le climat, en France), les propositions qui en résultaient était bien plus progressistes que celles effectivement appliquées. Et de conclure : « Les projets citoyens innovants sont essentiels, mais pour les généraliser et les adapter aux contextes locaux, l’heure est au sabotage. »
Activisme et monde du travail
Nous ne développerons pas ici sur le cinquième chapitre, qui retrace le parcours personnel de la militante, et donne de bonnes clefs de compréhension sur les manières possibles d’agir, et sur les déceptions que certains modes d’engagement peuvent entraîner – c’est un récit incontestablement utile, mais le résumer serait le trahir. Il nous amène directement au sixième chapitre, qui aborde une question régulièrement soulevée dans les milieux activistes : celle de la résilience de nos mouvements.
En partant de sa propre expérience, celle d’un burn-out qui a dû mener à son hospitalisation, l’autrice pointe le problème central de la logique activiste : sommé∙es de multiplier les actions spectaculaires en l’absence d’un mouvement de masse, les militant∙es s’épuisent, se confrontent aux défaites à répétition, se laissent ronger par l’éco-anxiété, et beaucoup d’entre elleux passent à autre chose après quelques années. Et cette énorme demande en temps et en énergie n’est pas pour rien dans la faible représentation des classes populaires au sein de ces milieux. Mais si les solutions proposées (laisser de la place aux émotions, valoriser une culture de l’imperfection, rompre avec le culte de la personnalité) sont toujours bonnes à prendre, aucune ne semble vraiment régler le problème.
C’est seulement dans ce chapitre, et sous cet angle de l’épuisement, qu’est abordée la question du travail : l’autrice rappelle à raison que le meilleur geste que l’on puisse faire individuellement pour protéger l’environnement, ce serait de « ne rien faire du tout » – ne plus travailler, ne plus produire, ne plus transporter… et se reposer. D’où une prise de distance utile vis-à-vis d’une culture militante qui pousse à être le plus actif∙ves, le plus productif∙ves possible.
Mais cette question du rapport au travail aurait mérité d’être développée bien plus longuement. Car pour mener une « révolution anticapitaliste et décoloniale », ni les projets de niche, ni les actions menées par des activistes astucieux∙ses ne peuvent suffire. Même les actions de Code rouge n’ont rassemblé que quelques milliers de personnes (2)Lire notamment sur notre site Code rouge 3 : quand les jets privés se taisent, les matraques chantent, ce qui suffit pour taper au bon endroit au bon moment, mais pas pour engager de véritables rapports de forces avec la classe dirigeante, son pouvoir économique, et son bras armé. Comme beaucoup d’entre nous, Esmeralda Wirtz n’a pas connu de tels mouvements de masses, qui ont cruellement manqué ces dernières décennies, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas travailler à leur retour.
Or, ce qui empêche la classe travailleuse d’entrer massivement en action, et tout particulièrement de s’engager dans un mode de militantisme aussi exigeant que l’activisme, c’est précisément le travail, qui occupe l’essentiel de nos emplois du temps. On ne peut donc que regretter que dans la liste des modes d’actions qu’elle cite, Esmeralda Wirtz oublie systématiquement le seul d’entre eux qui libère plus de temps qu’il n’en demande : la grève.
Ce livre est un excellent guide pour penser un projet de société alternatif, et tout autant pour agir ici et maintenant avec les moyens du bord. Mais cet angle mort sur nos capacités de lutter, non seulement en tant que personnes « vulnérabilisées », non seulement en tant que militant∙es, mais également en tant que travailleur∙ses indispensables à la machine capitaliste, empêche de penser l’affrontement à bien plus grande échelle qui sera tôt ou tard nécessaire. Affrontement qui suppose une grève générale, et donc la construction, bien en amont, de rapports de forces dans le monde du travail lui-même.
Récemment, les actions « activistes-syndicalistes » menées notamment contre les partis politiques au gouvernement wallon, puis contre Engie dans le cadre des actions de Code rouge, et enfin par la coalition Commune colère, ont représenté un pas important dans cette direction. Espérons que le reste du mouvement climat s’engage dans cette voie.
Photo : Couverture du livre « Les vrai∙es héro∙ïnes de l’écologie » d’Esmeralda Wirtz.
Notes