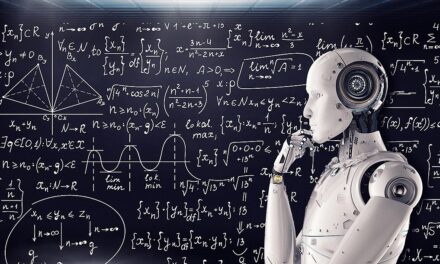Réflexions autour de l’ouvrage « Te plains pas, c’est pas l’usine »

Te plains pas, c’est pas l’usine, l’exploitation en milieu associatif
niet ! Édition
On entend souvent dire aux travailleuses(1)Nous utiliserons ici en majorité le féminin, étant donné que le secteur est fortement féminisé. du secteur associatif et socio-culturel(2)Les limites de ce secteur sont floues, on pourrait y inclure en Belgique toutes les ASBL, les ONG, les syndicats… qu’elles ont de la chance de vivre de leur passion, de faire un travail qui a un sens, et qui, au final, n’est pas vraiment un travail. Après tout, on s’investit pour la bonne cause, les structures sont plus « humaines », il n’y a pas vraiment de chef et de subordonnées, on travail tou.te.s ensemble pour un noble projet de société.
Pourtant lorsqu’on se penche davantage sur le fonctionnement des ASBL, force est de constater que la souffrance au travail, les burn out, et les violations du droit du travail y sont légion. Les temps partiels contraints, les heures supplémentaires non rémunérées, les contrats précaires, le manque de matériel, le sous-effectif structurel foisonnent dans ce secteur, et lorsque l’on a le « privilège » d’avoir un CDI temps plein, la charge de travail est souvent impossible à gérer.
Face à ces souffrances, la seule marge de manœuvre pour la travailleuse est souvent le départ, la démission, ou dans le cas des burn-out et des harcèlements, la maladie de longue durée. Les travailleuses se sentent souvent seules, et culpabilisent de ces ruptures, ou pensent à la limite qu’elles sont tombées sur une boite particulièrement maltraitante, un cas isolé. Face à la multiplication de ces témoignages, les autrices de l’ouvrage « Te plains pas, c’est pas l’usine » ont décidé de décrypter les origines matérielles de ces souffrances.
Origines structurelles des souffrances dans le secteur associatif : le cas belge
Si les autrices parlent d’un contexte spécifiquement français, force est de constater que le contexte belge est très similaire. Exposons-en ici un aperçu. Les associations sans but lucratif sont créées en Belgique en 1921. Pour être définies comme telles, elles doivent poursuivre un but désintéressé, tous les bénéfices éventuels doivent être reversés directement au fonctionnement de l’ASBL, et elles doivent être gérées par un conseil d’administration bénévole. On le voit, les ASBL belges ont un fonctionnement quasiment identique aux associations françaises définies par la loi de 1901.
La constitution des ASBL fait suite à l’obtention de la liberté d’association pour le mouvement ouvrier qui a dû longtemps batailler pour être reconnu juridiquement. Cette institutionnalisation, fruit d’une lutte sociale, comporte pourtant l’avantage pour l’État et son gouvernement de mieux contrôler les diverses formes d’association et d’ainsi neutraliser leur potentiel révolutionnaire(3)La grande différence avec le contexte français, c’est la pilarisation de la vie sociale, et donc la constitution d’association socialistes, chrétiennes (et parfois même libérales)..
À partir des années 70-80, les ASBL connaissent un véritable essor, car pour limiter les dépenses publiques, l’État va transférer les missions qui incombent au service public, et donc aux fonctionnaires, vers le secteur associatif. L’idée est claire, démanteler le service public, « trop couteux », et faire appel à un « sous-fonctionnariat » au statut bien moins protégé, à savoir les travailleuses des ASBL(4)En Belgique, ce démantèlement néo-libéral s’est fait en parallèle avec la communautarisation et la fédéralisation de l’État, et donc le morcèlement des services et des budgets..
En outre, à partir des années 70, les luttes féministes, LGTBQI+, antiracistes, écologiques s’organisent mais sont ignorées par le mouvement ouvrier et les syndicats et connaissent les mêmes processus d’institutionnalisation (planning familiaux, MRAX, maisons des femmes, Inter-environnement, Maison Arc-en-Ciel).
Le processus de démantèlement des services publics, on le sait, a continué progressivement jusqu’à nos jours. Lors du passage de l’État-providence vers l’État social actif dans les années 90 (tournant néolibéral instauré par le PS), les pouvoirs publics ont décidé, petit à petit, de remplacer les budgets structurels alloués aux ASBL par des budgets « par projet ». Ainsi, ils réduisent encore les dépenses publiques, puisque les ASBL sont sommées de faire rentrer de l’argent en dehors des subsides. Ils obligent les ASBL à se lancer dans la course effrénée de recherche d’argent, contrôlent d’avantage le secteur associatif (les exigences administratives, comptables et évaluatives ont connu une terrible inflation), et rendent les associations « compétitives » entre elles. Selon les desiderata politiques du moment, l’État peut ainsi décider à qui il va donner une enveloppe et à qui il ne va plus octroyer de budgets. Les ASBL se retrouvent donc à prendre un temps considérable pour remplir de la paperasse interminable afin de justifier leur existence, et ont bien moins de temps pour remplir leurs missions d’origine. Elles perdent ainsi encore plus d’autonomie dans la capacité à maitriser leur propre agenda et à effectuer un travail de fond sur le temps long, tout en étant confrontées à un public de plus en plus broyé par les difficultés provoquées par la crise économique, sanitaire, sociale et culturelle et donc parfois de plus en plus agressif et/ou abandonnant.
Un sous-effectif organisé
Hormis les budgets par projet, et les éventuels bénéfices engendrés par l’association, quelles sont les marges de manœuvre des ASBL pour employer des travailleuses ? Nombre de subsides précaires ont été développés par les pouvoirs publics dans le courant des années 1980-2000, entre autre :
- À Bruxelles, les Agent Contractuels Subventionnés (ACS) sont créés par le gouvernement Charles Picqué (PS) en 1996(5)Ils remplacent les Troisième Circuit de Travail (TCT ). Si les ACS sont vus par les pouvoirs publics comme étant une mesure « d’activation » des chômeurs, ils fonctionnent de facto comme une aide structurelle au secteur non-marchand. En fait, ce financement constitue la seule ressource pour certaines ASBL. En 2017, la Région subventionnait environ 10.000 postes ACS dont plus de 7.000 correspondaient au dispositif « Loi Programme » (ASBL et Administration) et 2.500 étaient des ACS « Pouvoirs locaux » (CPAS, et communes)(6)Ces ACS viennent d’être abandonnés en décembre 2020. C’est employées sont à 63% des femmes, et constituent 2,3% de la population active à Bruxelles, un chiffre énorme(7)https://www.cbcs.be/ACS-remettre-au-travail-des. Depuis récemment, les pouvoirs publics ont voulu réaffirmer le caractère « d’activation » de ces financements, pourtant vitaux pour le secteur non marchand. Il a alors été décidé que les seuls nouvelles conventions proposées seraient des CDD d’un an et demi. Les ACS sont à nouveau considérés comme un tremplin pour un « vrai » travail. Or, dans le socio-culturel bruxellois, l’immense majorité des contrats proposés sont des ACS, cherchez l’erreur…
- Initiées en 1999 par Onkelinx (PS), les conventions premier emploi (CPE) fonctionnent dans la même logique, pour l’activation des jeunes de moins de 26 ans. Édictées au niveau fédéral, ces CPE ont l’avantage d’être exonérées de cotisations sociales, et coûtent donc moins cher aux patrons. Les entreprises privées les utilisent mais les pouvoirs publics comme la FWB aussi. La FWB affecte des CPE à des employeurs du secteur non marchand. Après les 26 ans révolus, l’association doit trouver une nouvelle travailleuse(8)Sur le terrain, il a déjà été vu des CPE qui étaient les seules travailleuses hormis la direction, et qui devaient donc assumer toutes les tâches de l’association..
- Le fonds social Maribel permet de libérer un fonds grâce aux exonérations de cotisations sociales pour engager des travailleuses supplémentaires. Cependant, il ne s’applique pas aux ASBL qui n’emploient que des ACS et des CPE.
- Les articles 60, sont peut-être les pires de ces contrats. Le CPAS propose de mettre une bénéficiaire d’allocation au travail, et de la détacher en association pour un an et demi. Ces allocataires, toujours précaires, et bien souvent issues de l’immigration, ou primo-arrivantes, se retrouvent à faire les tâches considérées comme « ingrates » mais indispensables de l’association (secrétariat, manutention, entretien). Et comme pour les CPE, après un an et demi, il faut changer de travailleuse.
Ce récapitulatif un peu ardu permet cependant de déterminer clairement une chose : les pouvoirs publics n’octroient presque que des plans d’activation aux ASBL. Pour le reste, elles sont priées d’engager des employées avec leurs fonds propres (souvent très faibles), et de s’auto-financer, comme des entreprises privées.
Une « idéologie du dévouement et travail gratuit »
On le voit, la plupart des associations sont donc sous-financées, et en sous-effectif structurel. Que faire si on n’a pas assez de personnel ? Compter sur des travailleuses au salaire bas, ou compter carrément sur le travail gratuit. Tout d’abord, pour assumer la charge de travail, de nombreuses travailleuses à temps partiel sont très souvent contraintes de faire des heures supplémentaires non rémunérées (combien de personnes officiellement à mi-temps se retrouvent à travailler un équivalent temps plein ?). Le temps-partiel est plus répandu dans le secteur associatif, et le niveau des salaires y est inférieur à la moyenne en Belgique(9)Cf. les études de la Fondation Roi Baudouin : https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2020/20200511NDisbl. Ensuite, on fait appel à des indépendantes (guides, artistes, techniciennes), des étudiantes, mais aussi et surtout à des volontaires et des stagiaires pour plâtrer les fissures du sous-effectif. En Belgique, l’État n’oblige pas de rémunération minimum pour une stagiaire. On voit donc souvent des stagiaires rester pour des missions de trois à six mois sans toucher la moindre contrepartie.
La main d’œuvre gratuite ou bon marché ne manque pas, dans le secteur. Tout d’abord car il y a un attrait particulier du secteur associatif, parce qu’il est intéressant, culturel, politique… et (re)donne du sens pour celles et ceux qui veulent fuir le monde de l’entreprise privée. En outre, la pression « de l’armée de chômeuses » est peut-être encore plus forte qu’ailleurs : étant donné le peu de nombres de postes à pourvoir, les travailleuses se battent pour obtenir des postes exécrables, souvent dans l’espoir d’accumuler de l’expérience et/ou d’être stabilisées à moyen terme, et si elles s’en plaignent, des dizaines de personnes sont prêtes à les remplacer. C’est ce rapport de forces qui permet aux associations d’être extrêmement exigeantes dans leur embauche (polyvalence, diplômes multiples, expériences, multilinguisme) ce qui creuse évidemment les inégalités socio-économiques. On embauchera plus facilement une personne qui a eu les moyens de faire des stages multiples, des séjours à l’étranger, qui a plusieurs masters, etc…
Ce manque de moyens a aussi des conséquences sur la qualité du travail. On fait souvent avec les moyens du bord, on bricole. Tout est flou, rien n’est vraiment défini. Les travailleuses reçoivent sans cesse des injonctions contradictoires : il faut être « polyvalentes » parce qu’on doit tout faire en même temps, mais il faut spécifier les postes de chacune pour être plus efficaces. Être « proactives » parce qu’on est souvent seules sur les projets, mais ne rien décider sans l’aval de la direction.
Un secteur extrêmement féminisé
Énormément de femmes travaillent dans le secteur associatif, plus de 70% en Belgique. D’un côté, le non-marchand exige des qualités qui incombent socialement aux femmes : le dévouement, l’accompagnement, l’écoute, l’empathie, le soutien ou le soin à la personne, la pédagogie, la médiation sociale, culturelle… Il s’agit souvent de travail reproductif, historiquement dévalorisé, invisibilisé et considéré comme gratuit, secondaire, allant de soi, véritable sacerdoce. Avant la professionnalisation des associations, les tâches sociales ou de soin aux autres étaient toujours dévolues aux femmes, que ce soit par le dévouement des bonnes sœurs, l’implication des femmes de la bourgeoisie à travers les œuvres de charité chrétienne, dans les associations féminines ouvrières ou au sein du ménage. D’un autre côté, il existe un processus clair de féminisation des secteurs socialement et économiquement dévalorisés : si la culture, la médecine (de première ligne), l’enseignement ou la psychologie étaient une affaire d’hommes au XIXe siècle, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Mais les hommes ne sont pas tout à fait absents du secteur non-marchand. Ils sont cependant extrêmement valorisés, briguent souvent les postes de direction ou de coordination, les temps pleins, les fonctions les mieux payées, dans un processus qu’on appelle « l’escalator de verre »(10)https://journals.openedition.org/rsa/1023?fbclid=IwAR27noq8zTFFRwQTUpy4UW1vcw0JQWDLJv1_4zvpgwbHR67-Lpk6jI3TE7c. Leur progression de carrière tend à être plus favorable que celle de leurs collègues féminines.
Les associations même les plus progressistes n’échappent pas aux structures de domination présentes dans le reste de la société. Il n’est donc pas rare de rencontrer des ASBL qui sont composées d’une direction masculine, d’une équipe de femmes blanches, et de femmes et d’hommes issus de l’immigration ou primo-arrivants pour effectuer les tâches les plus « ingrates » (accueil, secrétariat, ménage, manutention, logistique)(11)Notons par ailleurs que lorsque la direction se féminise, elle applique tout de même les mêmes recettes managériales. Si on ne remet pas en question les modèles économiques qui sous-tendent l’exploitation et la domination, diversifier l’identité de ceux et celles qui nous exploitent ne changera quasiment rien..
Un patronat qui ne dit pas son nom
Les associations sont des structures généralement très restreintes. Tout le monde s’y connait. Souvent, puisqu’on travaille pour un projet humaniste/progressiste, qu’il soit social politique ou culturel, l’ambiance est de prime abord familiale, les travailleuses se sentent sur un pied d’égalité avec la direction, qui se bat après tout pour la même cause qu’elles. Ce n’est pas une direction d’entreprise privée, ici pas de profit sur le dos des travailleuses, on est dans le non marchand !
Pourtant, la direction existe bel et bien, même si certaines d’entre elles ne s’assument pas comme telles. Il y a évidemment les membres du conseil d’administration, ce sont des « dirigeants bénévoles », parfois pourvus d’un capital économique, souvent d’un capital social et culturel élevés. Mais il y a aussi un chef (certains provenant de plus en plus du privé, ou ayant fait des études de gestion ou de business). S’il n’exploite pas économiquement ses travailleuses, et que les décisions ne lui incombent pas tout à fait puisqu’elles dépendent des pouvoirs publics et/ou d’un conseil d’administration, son pouvoir est plus diffus, donc plus pervers. Il doit arriver aux exigences quantitatives des pouvoirs subsidiants, trouver suffisamment de recettes pour financer l’ensemble du fonctionnement de l’ASBL. Pour ce faire, il a souvent recourt aux techniques managériales d’entreprises privées. Il a par ailleurs le pouvoir de décision en termes de licenciements, d’engagement, de bricolage avec les subsides(12)Le CA agit rarement comme lieu de contre-pouvoir. De fait, il s’agit plus souvent d’un lieu de sociabilité des chefs, qui n’est pas neutre socialement. En outre, dans certaines ASBL, les CA ne sont que des hommes de paille, face au projet d’une seule personne. .Enfin, sa position lui confère toujours des avantages matériels et symboliques.
Il n’y a pas souvent de délégation syndicale dans ces petites structures. Les travailleuses associatives font partie des secteurs les moins bien payés et les moins syndiqués du pays. Les travailleuses se retrouvent à devoir défendre leurs conditions de travail de manière individuelle. Isolées, elles sont contraintes d’accepter des situations extrêmement violentes en termes de droit du travail(13)Renoncer à son pécule de vacances, accepter des horaires impossibles, renoncer à la rémunération ou la récupération de ses heures supplémentaires, renoncer à son ancienneté, avoir la pression pour ne pas tomber enceinte, travailler avec du mauvais matériel… . Pour faire accepter ces violations à des travailleuses sous-payées, la culpabilisation et la manipulation émotionnelle sont des stratégies fortement utilisées, et particulièrement présentes dans le domaine social et le domaine du soin aux personnes : « si personne ne le fait, les bénéficiaires vont être dans la merde », « il faut que l’ASBL reste à flot » « on va mettre la clef sous la porte », etc. On valorise par ailleurs les salariées qui ne comptent pas leurs heures « pour la cause » tandis que celles qui seraient regardantes sur leurs droits et leurs horaires sont vues comme de mauvaises employées, des « fonctionnaires » ou des personnes qui n’aiment pas leur travail.
Comment lutter ?
Face à ces constats alarmants que faire ? Il y a plusieurs pistes de stratégies à explorer.
Il faut tout d’abord remettre l’église au milieu du village : Le travail associatif est avant tout…un TRAVAIL, ce n’est ni un hobby, ni un sacerdoce, , mais un travail salarié qui n’échappe magiquement pas au droit du travail.
Une première étape est la prise de conscience collective des problèmes structurels et des choix néo-libéraux effectués tant par les pouvoirs publics que par les directions d’ASBL. Si les souffrances sont multiples, c’est parce que la situation matérielle est catastrophique. Il est nécessaire de re-collectiviser les problèmes individuels en organisant des réunions d’équipe sans la direction (et les coordinateurs) pour partager ses expériences. Il faut exiger d’améliorer au moins les conditions de travail à défaut de pouvoir augmenter les salaires, s’occuper des risques psycho-sociaux des travailleuses notamment. L’équipe doit par ailleurs être solidaire avec les travailleuses les moins bien payées et dont les fonctions sont les moins valorisées. Il est aussi très important de se syndiquer, notamment pour avoir une personne référente vers qui se tourner s’il y a des manquements au droit du travail. Il faut à tout prix dépasser le réflexe corporatiste qui masque les rapports de pouvoir au sein du secteur. La direction n’est pas dans le même bateau que les travailleuses.
S’il est difficile de s’organiser au sein de son association, il est possible de s’organiser de manière sectorielle. Organiser des actions par commission paritaire par exemple, se réunir en tant que travailleuses d’association, travailleuse du secteur socio-culturel, de l’éducation permanente, et partager son expérience commune…S’organiser est la clef pour avoir un rapport de forces suffisant afin de faire bouger les lignes.
Il est important de réaffirmer le rôle indispensable du secteur associatif et non marchand, que ce rôle soit social (asbl féministes, anti-racistes, associations de quartiers, maison des jeunes, planning familiaux, ) ou culturel (musées, asbl liées au théâtre, au cinéma, centres culturels). Ces services doivent être des structures au service de leurs publics. En cela, la grève internationale des femmes lors du 8 mars est un vecteur de lutte important pour le secteur associatif. Le lien est clair avec le combat féministe : le secteur est extrêmement féminisé, compte sur le travail reproductif des femmes, et reste mal payé et peu considéré malgré le fait qu’il s’agisse d’un travail indispensable à la société. Le 8 mars est donc l’occasion pour les travailleuses du secteur associatif de s’arrêter, de faire actions spécifiques, de se réunir entre travailleuses pour partager ses expériences…Plusieurs actions vont être organisées par les syndicats et travailleuses du secteur en ce sens, que la Gauche anticapitaliste et Feminisme Yeah relayeront et soutiendront.
Dans un modèle de rupture avec 40 ans de capitalisme néolibéral, contre cette sous-traitance des missions publiques et le management par projets, la perspective de transformation sociale des anticapitalistes est de défendre un secteur associatif qui soit à la fois fort, public, massivement refinancé et organisé en autogestion démocratique des travailleur.se.s et des publics concerné.e.s.
Notes