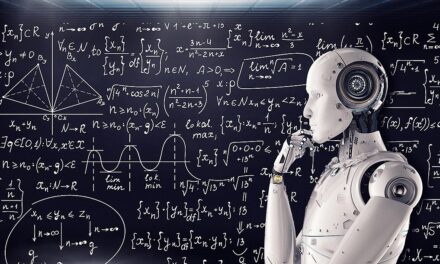Cela fait maintenant plus de six mois que le monde traverse une crise sanitaire, sociale et économique aux dimensions historiques. En dresser une analyse économique n’est pas simple. D’abord parce que la crise n’est pas terminée, loin de là. Ensuite, parce que pour des raisons de compilation et de traitement, tous les chiffres ne sont pas encore disponibles. Enfin, parce que nous n’avons pas le recul suffisant pour apprécier les choses dans toutes leurs dimensions. Ce dernier point est encore plus vrai si on considère que des mesures de confinement continuent à être mises en place pour faire face à des reprises localisées de l’épidémie. Tout en conservant ces éléments à l’esprit, tentons l’exercice.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers mois ont été caractérisés par un fort ralentissement des activités économiques. La consommation des particuliers s’est fortement réduite durant le confinement et est ensuite restée bien en-deçà de son niveau pré-crise. Si les fermetures des magasins et les restrictions de déplacement ont eu un lourd impact, la persistance d’une consommation déprimée s’explique aussi par les baisses de revenu pour les un.e.s, l’incertitude quant à l’avenir pour les autres, ou simplement la peur du risque sanitaire.
Du côté des entreprises aussi, les dépenses ont été comprimées. Leurs investissements chuteraient de plus de 20% en 2020. Ceci, en raison du gel ou du ralentissement des activités, donc des débouchés, de l’incertitude quant à l’avenir et des effets de la baisse drastique de la rentabilité observée dans plusieurs secteurs. Le capital ne pouvant tout simplement plus être valorisé suffisamment, il n’est plus – ou en tout cas moins – mis en circulation.
Quant à l’exposition au reste du monde, la situation économique globale provoque un recul des marchés potentiels d’exportation pour la Belgique de 11%. Pour une économie fortement ouverte, c’est un réel coup dur.
Au final, les estimations les plus récentes portent à près de 10% la perte de PIB pour l’année 2020. C’est un recul de l’activité économique tout à fait historique pour le capitalisme belge.
Face à cette crise, les différents gouvernements du pays ont déployé une panoplie de mesures de soutien. Parmi celles-ci, citons simplement le moratoire sur les faillites, l’extension et la facilitation d’accès au chômage temporaire pour force majeure et le droit passerelle(1)En quelques mots, le droit passerelle est une allocation financière mensuelle que peuvent percevoir, sous certaines conditions, les indépendant.e.s, les aidant.e.s et les conjoint.e.s aidant.e.s qui doivent stopper leurs activités pour une série de raisons comme une faillite, une catastrophe naturelle, un incendie, etc. Les conditions d’accès à cette aide ont été assouplies pour couvrir les indépendant.e.s étant touchées par le COVID19. Et elles ont concerné beaucoup d’entreprises, de travailleur/euses et d’indépendant.e.s.
En juillet, presque 62.000 employeurs faisaient encore appel au chômage temporaire pour force majeure. Ils étaient plus de 140.000 à le faire en avril. Du côté des travailleurs/euses – toujours en juillet – 395.000 d’entre eux étaient touché.e.s par le chômage temporaire pour force majeure, contre 1.230.000 en avril. Enfin, on évalue à près de 405.000 le nombre d’indépendant.e.s qui ont bénéficié du droit passerelle.
À travers ces mesures, et d’autres, le Bureau fédéral du Plan estime que 60% de la perte de revenu national en 2020 a été absorbée par les pouvoirs publics. Ceci s’est évidemment fait au prix d’une explosion des dépenses de ces derniers, dans un environnement de contraction des recettes. Par conséquent, le déficit public devrait s’élever à 11% du PIB en 2020, ce qui représente 45 milliards d’euros. Quant à la dette publique, elle ferait un bond à 120% du PIB cette même année contre 98% en 2019.
Un choc aux répercussions très inégales
Mais si la crise est d’une ampleur considérable dans son ensemble, son impact est aussi très inégalement réparti. Au niveau géographique, au niveau sectoriel et entre catégories sociales.
Bien sûr, ces dimensions se recoupent de manière importante. Ainsi, une région sera plus gravement touchée si les secteurs les plus en difficulté en constituent une grande part de son tissu économique. La crise sera plus fortement ressentie là où les secteurs de l’horeca, de l’événementiel(2)En raison du risque sanitaire et des mesures prises, les activités artistiques ont été stoppées nettes et sont encore aujourd’hui fortement ralenties. De par leurs statuts notamment, les artistes sont parmi les grand.e.s oublié.e.s des mesures de crise et doivent faire face à des difficultés socio-économiques croissantes., et du commerce non-alimentaire sont importants. Ces secteurs ont connu des pertes de vente parfois supérieures à 70% par rapport aux mois d’avril et de mai de l’année précédente. On pense aussi à l’automobile et à l’aéronautique. Concernant le premier, ce sont surtout les équipementiers – producteurs de pare-brise, de suspensions ou de matériels électroniques pour automobiles – qui sont les plus touchés en raison de leur dépendance aux exportations ; les deux usines d’assemblage de Belgique pouvant, elles, compter sur la production de modèles populaires, comme à Gand pour Volvo, ou étant un lieu de production unique pour un modèle précis, comme à Forest pour Audi. Quant au second, l’aéronautique, les difficultés de Brussels Airlines et la faillite de Swissport parlent d’elles-mêmes. Il se peut, par contre, que la crise soit relativement moins douloureuse là où des entreprises actives dans la chimie et le pharmaceutique sont implantées, car celles-ci ont moins souffert. De même pour les entreprises qui ont pu largement recourir au travail à distance et les secteurs qui, par leur nature, sont moins sensibles aux cycles économiques, comme les administrations publiques et l’enseignement par exemple.
Au-delà de cet aspect sectoriel, ce sont aussi d’autres caractéristiques qui jouent, comme la taille des entreprises, leur dotation en trésorerie ou le nombre de travailleurs/euses. En effet, ce sont les plus petites structures qui ont jusqu’ici le plus témoigné de difficultés et de pertes financières relatives. Si cela reflète des réalités économiques différentes, c’est aussi une conséquence d’une capacité inégale à faire valoir ses intérêts. Les plus grandes entreprises ont été bien plus que les autres reconnues comme « essentielles », et ont donc pu mieux poursuivre leurs activités. De nouveau, cette dimension se combine avec la géographie. La Région wallonne, par exemple, se caractérise par une présence plus importante d’entreprises de plus petites tailles et/ou moins bien dotées en trésorerie. Elles ont donc plus de mal à tenir le choc du ralentissement des ventes, et sont plus susceptibles de faire faillite. De même à Bruxelles, où les petites structures sont nombreuses et pourvoyeuses d’emplois. Là aussi, elles sont menacées : l’entreprise d’information financière Graydon signale que près de 30% des commerces de détail de moins de 50 travailleurs ne survivront pas à la crise.
Et puis, certains secteurs ont une structure d’emploi très particulière, qui fait que lorsqu’ils sont touchés, ce sont aussi des groupes de population spécifiques qui le sont. Leur main d’œuvre est par exemple très féminisée, racisée ou peu qualifiée, publics déjà plus vulnérables sur le marché du travail en raison de facteurs d’oppression et d’exploitation socio-économiques supplémentaires et renforcés. Cette dimension structurelle s’ajoute au fait que, traditionnellement, lors de crises économiques et de hausse du chômage, ce sont déjà les publics les plus précarisés sur le marché du travail qui sont les premiers à en être expulsés.(3)À cet égard, il est important de prendre les chiffres officiels avec précaution. En effet, des mécanismes à l’œuvre sur le marché du travail dissimulent l’ampleur du chômage, du non-emploi et de la précarité en emploi. Par exemple, les fins de contrats temporaires brouillent les chiffres des licenciements, les destructions d’emplois informels n’y apparaissent pas, et beaucoup de personnes fragilisées ne sont pas reprises dans toute une série de statistiques car elles ne sont pas forcément inscrites auprès des services d’emploi. Le résultat est qu’on observe dans certaines communes de Bruxelles comme Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek ou Saint-Josse, une baisse du nombre de chercheurs/euses d’emploi par rapport à l’année précédente, alors que les chiffres augmentent partout ailleurs. En définitive, la situation est bien pire que ce que les chiffres administratifs laissent entendre.
Mentionnons maintenant la possibilité du travail à distance. On se souvient de la multiplication des reportages et des articles de presse dans lesquels cadres supérieurs et consultants s’extasiaient du rôle presque magique du télétravail. Sauf que la possibilité de rester à domicile, de travailler à distance sans perte de revenu, n’est pas à la portée de tou.te.s. Et si elle n’existe pas, les personnes concernées auront probablement dû être mises au chômage temporaire pour force majeure, perdre leur emploi, ou continuer à travailler en étant exposées au risque sanitaire. En Belgique, on remarque que ce sont les personnes moins qualifiées, aux contrats atypiques et ayant des revenus en moyenne plus faibles qui sont les moins susceptibles de pouvoir bénéficier du télétravail. C’est pourquoi, elles étaient aussi surreprésentées dans la mise au chômage temporaire, comme ce fût le cas dans les titres-services au plus fort du confinement, ou particulièrement exposées au risque sanitaire, comme ce fût le cas pour les caissières et, bien évidemment, les infirmières et aides-soignantes. Le constat est le même au niveau international : les emplois qui ne peuvent se faire à distance – en télétravail – sont aussi plutôt occupés par des personnes en moyenne plus faiblement qualifiée et plus mal payées, dans des secteurs particuliers qui comptent parmi les plus touchés par la crise, et dont certains ont une main d’œuvre assez fortement féminisée et/ou issue de l’immigration. À nouveau, les mêmes personnes sont identifiées : travailleuses du nettoyage, aides à domicile, caissières, infirmières, aides-soignantes, chauffeurs/euses de bus, etc.
Pour terminer, ce tour d’horizon ne saurait être complet sans traiter spécifiquement de la présence importante de travailleurs/euses sans papiers en Belgique, dont la situation sanitaire et socio-économique s’est très fortement détériorée. Partant d’une situation déjà particulièrement difficile, la crise du COVID19 est venue les frapper de plein fouet. Ces personnes sont en effet très présentes dans les secteurs identifiés précédemment – l’horeca, le nettoyage, le gardiennage – en plus de n’avoir pas accès à la citoyenneté et donc de devoir subir des conditions de travail atrocement précaires et incertaines. Une main d’œuvre invisibilisée donc, qui aux yeux des autorités, ne mérite toujours aucune forme de reconnaissance.
On est donc bien confronté à une crise économique majeure qui est aussi très asymétrique. Ses effets risquent de générer ou d’accentuer des lignes de fractures entre secteurs économiques, entre régions et au sein de la classe travailleuse. En réalité, c’est déjà ce qui se passe. Les données d’enquête, les témoignages et les premières restructurations et faillites révèlent que les difficultés économiques et financières ont explosé dans l’horeca, l’événementiel, ou le petit commerce. Du côté des emplois, le Bureau fédéral du Plan remarque que les pertes se sont pour l’instant fortement limitées aux contrats de travail temporaires et atypiques. Le Conseil Supérieur de l’Emploi va dans le même sens, en ajoutant que l’exposition à la crise est déjà particulièrement forte pour les femmes et les personnes issues de l’immigration.
Au niveau humain, les conséquences seront très lourdes. Le Bureau fédéral du Plan s’attend à une hausse brutale du nombre de personnes en privation matérielle sévère, en manque de support social, ou se déclarant en mauvaise santé. L’impact de la crise actuelle sur le bien-être de la population serait d’ailleurs nettement plus important qu’en 2008.
Pour le reste, les effets se feront probablement sentir à plus long terme, même s’ils sont encore incertains. Assistera-t-on à des impacts fortement inégaux entre le nord et le sud du pays ? Le phénomène de reprise sera-t-il lui aussi asymétrique ? Les mêmes questions se posent à des échelons supérieurs : en Europe par exemple, comment évolueront les inégalités et les tensions internes au marché commun alors que certains pays dépendent bien plus que d’autres des activités directement et indirectement liées au tourisme ? Si la crise actuelle est source de divergences importantes, des conséquences politiques sont à prévoir.
Les mirages de la reprise
À l’entame de la crise sanitaire, l’objectif principal des mesures socio-économiques mises en place par les différents gouvernements était de créer un pont entre le monde « pré-corona » et celui d’après. La crise ne devait « pas durer longtemps », disaient les experts avec pignon sur rue, et une fois l’épidémie maîtrisée, l’activité économique pourrait être relancée. Ce qui était important, c’était d’éviter les destructions du tissu économique à court terme en soutenant les entreprises et les indépendants à travers des aides directes et indirectes. De cette manière, en préservant l’outil de production et la main d’œuvre, le redémarrage n’en aurait été que plus rapide. On était alors clairement dans l’anticipation d’une reprise en « V » voire en « U », la crise sanitaire et économique n’étant qu’un accident de parcours d’un régime de croissance… par ailleurs déjà moribond avant l’arrivée du virus.
Aujourd’hui, on ne peut que constater que la crise sociale et économique durera bien plus longtemps. Une reprise telle qu’initialement envisagée est remise en question par la résurgence des contaminations et des hospitalisations, qui s’accompagnent de mesures de confinement localisées. De plus, la crise a laissé des marques, y compris au niveau des comportements des consommateurs. Les enquêtes réalisées auprès de la population montrent qu’une peur s’est installée et que la reprise de la consommation ne se fera pas si facilement.
En outre, comme cité ci-dessus, dans un contexte incertain et face à des pertes parfois considérables, de nombreux capitalistes ont reporté ou tout simplement renoncé à des décisions d’investissements. Au plus fort du confinement, deux tiers des entreprises disaient avoir reporté leurs investissements, dont un tiers à un horizon encore inconnu. Or, dans une économie capitaliste, ce sont ces décisions d’investissement qui déterminent en dernière instance la poursuite de l’accumulation du capital, donc de la croissance. Sans une restauration suffisante de la profitabilité et des débouchés, un retour à grande échelle de l’investissement privé est peu probable.
C’est là d’ailleurs un autre élément essentiel d’une économie capitaliste : la détention du capital confère aussi à la classe possédante un incroyable pouvoir d’orientation sur l’économie, donc sur la satisfaction – ou non – des besoins individuels et sociaux. En période de crise, comme celle que nous traversons, la population aurait pu, dans un autre système économique et politique, décider démocratiquement d’un programme massif d’investissement dans les secteurs de la santé physique et mentale, dans la prise en charge des personnes vulnérables ou dans le développement d’activités économiques locales et respectueuses de l’environnement. Ce qui, en plus de répondre à des besoins sociaux urgents, aurait permis d’assurer du travail à de nombreuses personnes. Au lieu de cela, l’investissement privé est en baisse… un facteur d’aggravation de la crise. Les effets de telles opportunités manquées de changer de cap se font encore sentir des années plus tard. C’est l’une des raisons pour laquelle l’organisation capitaliste de la société est un frein au développement humain.
Enfin, pour rappel, les mesures destinées à « faire le pont » arrivent, ou vont arriver, à échéance. Il en est ainsi du moratoire sur les faillites, qui s’est terminé ce 17 juin 2020, à contre-courant des demandes des indépendants, des petites et moyennes entreprises, qui souhaitaient sa prolongation jusqu’à la fin de l’année. Quant à la mesure liée au chômage temporaire pour force majeure, elle était d’application jusqu’à la fin août. Au-delà, la mesure se prolongera jusqu’à la fin de l’année 2020 pour les patrons des secteurs particulièrement touchés par la crise du coronavirus et dont les entreprises sont particulièrement touchées par cette même crise. Plutôt que de laisser place à une reprise, la fin de ces mesures risque de ressembler à une rupture de barrage. Les autorités s’attendent d’ailleurs à une hausse importante des faillites et des pertes d’emploi – dont 145.000 demandeurs d’emploi supplémentaires d’ici 2021 – qu’elles espèrent absorber grâce à leurs plans de « relance » respectifs.
Dans l’ensemble, l’impact sur l’économie et l’emploi n’en est donc probablement qu’à ses débuts. La nécessité pour le capital de se refaire après une période de chute marquée des profits le poussera à se tourner vers le travail pour réaliser l’ajustement. Le capital belge devra néanmoins faire face à une difficulté structurelle majeure : la croissance de la productivité y est en perte de vitesse depuis des années et est aujourd’hui à ce point faible qu’il fallut récemment constituer un « conseil national de productivité » afin de se pencher sur la question. Ce qui pourrait pousser le capital à accentuer la pression sur les salaires, ou l’intensification du travail. Les premières tentatives ont déjà été posées, via un renforcement de l’extraction de plus-value du travail : postposer ou réduire les congés, travailler plus longtemps, augmenter la flexibilité du travail. En résumé, pour celles et ceux qui auront la chance de conserver leur emploi, l’accroissement de l’exploitation du travail dissimulé derrière les habituelles injonctions des dominant.e.s à « faire des efforts ».
Il existe cependant une barrière plus importante encore pour le capital, bloquant la reprise d’une accumulation qui lui est pourtant vitale. Les facteurs cités précédemment relèvent d’une logique plutôt classique de crise du capitalisme. Ils lui sont endogènes. On assiste certes à une crise du système capitaliste, mais la dimension écologique et sanitaire ne lui est pas, elle, entièrement interne. Si la destruction de l’environnement provoquée par les activités économiques est à l’origine d’une hausse du risque épidémique, le capital n’en contrôle pas les conséquences. Vous savez ce qu’on dit, « une fois que le dentifrice est sorti du tube »…
Ça veut dire qu’en l’absence d’un vaccin contre le virus, toute accélération de l’activité économique risque de s’accompagner d’une reprise des contaminations et donc d’une nécessité de mesures additionnelles de confinement, qui entraverait ladite accélération de l’activité. Le problème étant – et l’actualité le démontre – que le capitalisme est un système économique qui ne se satisfait pas d’une mise au ralenti de la sorte. L’accumulation du capital doit non seulement se poursuivre, mais se faire sur une base élargie et approfondie. Sans quoi, le capital ne peut être suffisamment valorisé, menant in fine à la crise.
Confronté à d’autres barrières par le passé, le capital pouvait compter sur sa reconfiguration ou sur un passage en force grâce à la mobilisation de l’Etat et de la force publique en sa faveur. C’est la raison pour laquelle les mesures sociales, obtenues de haute lutte, sautent les unes après les autres depuis le tournant néolibéral des années 1980, répondant à la nécessité des entreprises de se refaire une santé. Mais dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit pas seulement d’ouvrir et de soumettre de nouveaux domaines de la vie au règne de l’argent et au régime d’accumulation du capital. Il s’agit de passer outre des considérations fondamentales de la vie elle-même afin de poursuivre cette accumulation. Autrement dit, la bonne santé du capital passe ici et de manière frontale, par la mauvaise santé des individus et la mort de beaucoup d’entre eux. Un tel mépris pour la vie humaine est par ailleurs présent depuis le début de la crise dans le chef des décideurs économiques et politiques. La crise actuelle et toutes ses conséquences, sont une démonstration de plus de la brutalité d’un système capitaliste qui fait passer ses profits avant nos vies. Nous ne pouvons donc certainement pas nous permettre de rester spectatrices et spectateurs des manœuvres de la classe possédante. C’est en premier lieu à la classe travailleuse, et à ses organisations syndicales et politiques que revient la responsabilité de prendre la mesure de cette crise multiforme, de remobiliser les classes populaires et de transformer cette crise en crise politique pour le régime capitaliste lui-même, en offrant une issue solidaire et émancipatrice pour tou.te.s.
Notes