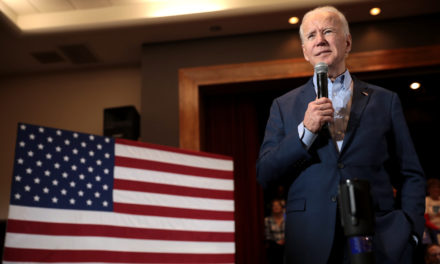La réélection du leader autoritaire russe se prépare sur fond d’une crise qui s’embourbe et d’une colère grandissante… (article traduit du russe par Mathilde Dugaucquier).
La prochaine élection présidentielle en Russie doit avoir lieu dans 4 mois, le 18 mars 2018. Bien que Vladimir Poutine n’ait pas encore exprimé la volonté de poser à nouveau sa candidature, il ne semble pas y avoir d’alternative possible au scénario d’un quatrième mandat. Conformément à la tradition de la « démocratie dirigée » qui s’est implantée en Russie ces deux dernières décennies, l’élection du président aura plus des airs de plébiscite du « père de la nation » que d’une compétition politique au résultat inattendu. Les stratèges du Kremlin envisagent ouvertement un plan baptisé « 70/70 », selon lequel le taux de participation aux élections doit atteindre 70 %, dont 70 % doivent à leur tour voter pour Poutine.
D’ailleurs, les partenaires attendus de Poutine dans ce spectacle électoral sont pratiquement les mêmes qu’en 2000, lorsqu’il était devenu président pour la première fois : le bon vieux leader des communistes Guennadiy Ziouganov, le populiste de droite Vladimir Jirinovski et le libéral Grigoriy Iavlinski. Il y a longtemps que les partis qu’ils dirigent respectivement se sont durablement installés aux commandes de l’administration du Kremlin, et toute action indépendante de leur part est strictement exclue.
De plus, toujours selon la tradition de la « démocratie dirigée », Vladimir Poutine ne participera pas aux débats et laissera cet exercice aux autres candidats. Poutine a pour sa part l’habitude de discuter directement avec ses électeurs à travers le programme « Ligne directe » retransmis par les chaînes de télévision d’État et au cours duquel « les gens simples » des quatre coins du pays peuvent, plusieurs heures durant, poser toutes les questions qu’ils souhaitent à leur leader. La propagande officielle ne cesse de marteler que Poutine est au-dessus de la politique, cette lutte sans fin des intérêts privés et des ambitions. Poutine est synonyme de l’actuelle grandeur du pays, du respect envers son passé et de la prévisibilité de son avenir (comme l’exprimait en son temps l’actuel président du parlement russe, Viatcheslav Volodin, « Poutine, c’est la Russie – La Russie, c’est Poutine »). Le vote pour Poutine apparaît de cette manière comme un choix rationnel guidé par le patriotisme, comme un test de fidélité à la nation. Ce n’est pas un hasard si le 18 mai, date de la « réunification » de la Crimée avec la Russie, a été choisi pour l’élection.
Le prix de la grandeur ?
Certains commentateurs politiques se plaisent aujourd’hui à écrire que le troisième mandat de Poutine (depuis 2012) s’est différencié des deux premiers (durant la première décennie 2000) en ce que les termes du contrat tacite liant la société au pouvoir ont changé : si au départ le pouvoir autoritaire proposait de troquer les libertés politiques contre une augmentation des revenus et la stabilité sociale, plus tard (surtout depuis 2014) la diminution des revenus est devenue le prix à payer pour défendre l’intérêt national face à un Occident hostile ; c’est ce qu’on appelle le « consensus criméen » dans la société.
De fait, il est vrai que la dépolitisation massive et l’apathie sociale des années 2000 étaient liées à une augmentation des revenus, garantie essentiellement par une conjoncture favorable sur le marché des hydrocarbures. C’était l’époque de la « stabilité », reconduite à travers les victoires électorales triomphales de Poutine et de son parti Russie unie pendant la décennie. La vague de protestation contre les fraudes aux élections législatives de décembre 2011 a sans aucune doute marqué la fin de cette période. Une minorité active, issue surtout de la classe moyenne des grandes villes du pays, avait alors montré qu’elle n’était pas prête à se satisfaire du système politique en place. C’est à ce moment-là que la menace de déstabilisation est devenue le principal argument de propagande des autorités, qui ont su garder le soutien passif de la majorité et s’assurer la réélection de Vladimir Poutine pour un troisième mandat en mars 2012. Mais avec la chute du prix des hydrocarbures et l’introduction de sanctions internationales contre la Russie suite à l’annexion de la Crimée en 2014, le pays est rapidement entré en période de récession économique.
Dans cette situation, le « plan anti-crise » du gouvernement de Dimitri Medvedev a consisté en une série de coupes claires dans les dépenses publiques, à l’image des politiques d’austérité en Europe, et en une tentative de prévenir l’augmentation des licenciements en exerçant des pressions sur le monde des affaires. Il est significatif que, en dépit de sa position de confrontation en politique étrangère, le gouvernement russe s’évertue à satisfaire les standards des instituts financiers internationaux en termes de « réformes de structure » et d’« assainissement des budgets » à travers la réduction du déficit (et des coupes budgétaires dans la sphère sociale en premier lieu).
Par exemple, il existe un consensus au sein des élites selon lequel il est nécessaire d’augmenter l’âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes (aujourd’hui 60 et 55 ans respectivement). Le gouvernement a également refusé d’indexer les salaires dans le secteur public alors que l’inflation progresse, ce qui provoque d’importantes pertes salariales. Il est intéressant de noter qu’au début de l’année 2017, la mission du FMI à Moscou a évalué positivement les mesures anti-crise du gouvernement Medvedev, tandis que le ministre des Finances, Siluanov, a déclaré que les conclusion du FMI « dans l’ensemble correspondent à notre estimation de la situation économique actuelle. »
L’augmentation massive de la pauvreté est la conséquence principale de cette crise qui progresse et des mesures néolibérales d’« assainissement ». Selon les estimations de la Banque mondiale, les rapports pour l’année 2016 montrent que le nombre des citoyens russes pauvres a augmenté d’un million, pour atteindre les 20 millions de personnes (le seuil d’extrême pauvreté, ou de misère, selon la Banque, se trouvant à un revenu de 1,9 dollar US par jour et celui de pauvreté à 3,1 dollars). Selon les données officielles, 21,4 millions de citoyens russes gagnent moins que le minimum nécessaire aujourd’hui équivalent à plus ou moins 150 euros, tandis que 70 % de tous les travailleurs perçoivent moins que le salaire moyen en Russie (environ 500 euros). Ainsi, la majorité des pauvres du pays sont des gens qui ont en fait un emploi.
Selon le dogme néolibéral, auquel la classe dirigeante russe est complètement acquise, la diminution du coût de la main-d’œuvre dans le pays doit améliorer son attractivité pour les investissements. Cette politique, qui mène de manière consciente à l’augmentation de la pauvreté, s’accompagne d’un écart accru entre les super-riches et la majorité de la population. La Russie contemporaine est un bel exemple d’inégalités sociales criantes : aujourd’hui, près de 35 % de la richesse nationale du pays appartiennent aux 100 plus riches, à côté desquels on compte encore
97 000 citoyens possédant plus d’un million de dollars.
Ainsi, en dépit des effets propagandistes certains de l’hystérie patriotique suite à l’annexion de la Crimée et dans le cadre de la « défense de nos concitoyens » à l’Est de l’Ukraine, il est peu probable que la lutte contre les ennemis extérieurs puisse faire longtemps office de base à un « contrat social » entre le pouvoir et une population qui s’enfonce dans la pauvreté. Il est même possible que l’élection présidentielle de 2018 soit le dernier moment où les sentiments anti-occidentaux pourront être mobilisés dans le sens du triomphe électoral de Vladimir Poutine.
La contestation qui gronde et l’opposition
Les manifestations qui ont eu lieu à travers tout le pays les 26 mars et 12 juin derniers sont un signe important de ce que le soutien au régime basé sur le « consensus criméen » s’effrite petit à petit.
Ces actions ont été les principales de l’opposition depuis 2011-2012 suite aux fraudes électorales. Cependant, les manifestations que nous voyons aujourd’hui se distinguent fortement des événements d’il y a cinq ans, tant en termes de revendications politiques que par leur base sociale. Cette fois, ce ne sont pas des slogans en faveur des libertés politiques et d’élections libres qui sont au premier plan, mais plutôt la colère contre la corruption et les inégalités sociales criantes. Un film réalisé par un groupe de l’entourage du populiste libéral Alexei Navalny a été l’élément déclencheur de la contestation. Cette vidéo, consacrée à l’immense fortune illégale de Dimitri Medvedev, a récolté 13 millions de vues sur YouTube en quelques jours mais n’a pas été jugée digne de commentaire par les autorités. Navalny a alors appelé toute personne souhaitant recevoir une réponse à descendre dans la rue.
Dans la plupart des villes, les autorités ont refusé d’autoriser les rassemblements et ont prévenu qu’elles étaient prêtes à les disperser par la force. En conséquence, les actions se sont conclues par des passages à tabac brutaux et des arrestations (par exemple, rien qu’à Moscou, plus de 1000 personnes ont été arrêtées le 26 mars).
Il y a près d’un an déjà, Alexei Navalny a annoncé son intention de participer à l’élection présidentielle, bien que les autorités lui aient fait comprendre dès le départ qu’en aucun cas elles n’autoriseront son enregistrement comme candidat officiel. Il a dès lors construit sa campagne comme antisystème, visant au démontage du système politique autoritaire en place dans le pays, et s’est attelé à la création de noyaux activistes dans toutes les grandes villes du pays. Au jour d’aujourd’hui, 76 bureaux de campagne ont déjà été ouverts et ils comptent près de 150 000 volontaires inscrits.
La campagne électorale de Navalny est plus un tremplin pour les mobilisations dans la rue qu’une campagne électoraliste. Lui-même a déjà déclaré que si les autorités ne le laissent pas participer, il appellera ses partisans à boycotter activement les élections et fera tout pour en saper la légitimité. Il faut noter que le format de la campagne – avec son leader inconditionnel et son modèle de direction vertical – ne laisse aucune place à la discussion démocratique ou au débat sur le programme et la stratégie du mouvement, qui sont définis par Navalny en personne et le petit cercle de conseillers qui l’entoure.
Navalny est un libéral qui a plus d’une fois montré qu’il pouvait avoir recours à tout type de rhétorique, y compris xénophobe et islamophobe, si cela s’avère utile à un moment donné. Cependant, il a dernièrement misé sur le populisme social puisqu’il parle de plus en plus de la pauvreté comme étant le principal problème du pays et attaque en permanence non seulement les fonctionnaires corrompus, mais également les super-riches. Sa récente polémique avec l’une des figures les plus riches de Russie (ainsi que de Suisse et de Grande-Bretagne), Alisher Usmanov, qu’il a accusé de s’être approprié des usines soviétiques illégalement durant les privatisations des années 1990, a fait monter son taux de popularité.
Aujourd’hui, la tâche de la gauche est de représenter une alternative socialiste et démocratique dans le mouvement de contestation qui prend de l’ampleur. Des espoirs concrets reposent à présent sur Sergueï Oudaltsov, la figure politique de gauche la plus connue, qui a été libéré il y a peu après avoir passé près de quatre ans en prison pour « organisation de troubles massifs à l’ordre public ». Sans entrer en confrontation avec Navalny, il est nécessaire, à la fois lors des débats publics et dans la rue, de démontrer à ses supporters en particulier, que la corruption et les privatisations illégales ne sont que des symptômes du modèle barbare du capitalisme post-soviétique, qui nous rapproche de plus en plus de la crise politique et économique.
Ilya Boudraïtskis