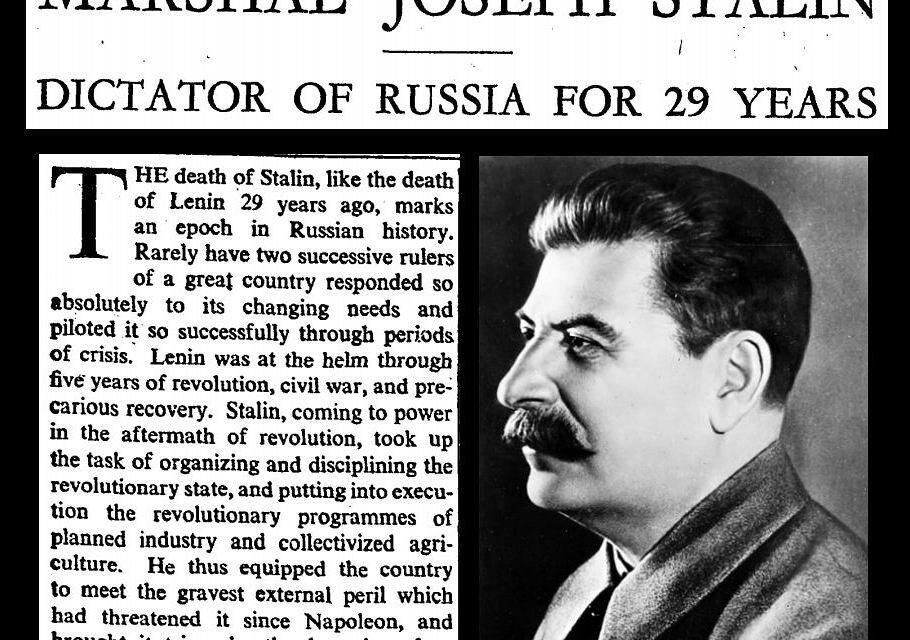« Toute la Russie pleurait : à partir de ce jour-là nous avons su que personne ne pensait plus pour nous. » Ces mots du poète khrouchtchévien Evtoutchenko témoigne du choc, mais aussi de la rupture, que la mort de Staline, le 5 mars 1953, constitua pour tou·te·s les Soviétiques et le mouvement communiste international.
Dans ses dernières années, Staline craignait tellement d’être assassiné qu’il avait choisi de ne plus dormir au Kremlin où il laissait toute la nuit la lumière allumée dans son bureau, afin de faire croire qu’il veillait en permanence sur le bien-être du peuple soviétique.
Soirée fatale à Kountsevo
Toutefois, lorsqu’il ne séjournait pas dans l’une de ses résidences luxueuses du Caucase, où il résidait la moitié de l’année, le dictateur passait ses nuits dans la datcha ultra sécurisée qu’il avait fait aménager à Kountsevo, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Moscou.
C’est là que le 28 février, après avoir passé, selon son habitude, la nuit à boire et à manger avec Beria, Boulganine, Khrouchtchev et Malenkov, il se retira peu avant 6 heures du matin dans ses appartements privés, où il ne dormait jamais dans la même pièce — pour des raisons de sécurité.
Khrouchtchev qui, dans les souvenirs qu’il a publiés en 1970, a laissé le récit le plus détaillé des évènements, affirme que la maisonnée attendit en vain vers midi, l’heure habituelle du réveil de Staline, que le dictateur sorte de ses appartements. Le personnel et les gardes du corps passèrent l’après-midi derrière les portes, tout aussi inquiet·e·s de l’absence de réaction de Staline que terrorisé·e·s à l’idée d’entrer sans autorisation dans ses appartements. Il fallut attendre 22 heures pour que les chefs de la sécurité décident courageusement d’envoyer une vieille femme de chambre dans les appartements de Staline. Elle le trouva par terre dans sa bibliothèque : baignant dans son urine, Staline avait tout le côté droit paralysé et gisait sans doute depuis de longues heures dans un état de semi-conscience.
Une lente agonie
Après avoir installé Staline sur un lit, le personnel de Kountsevo prévint Beria, qui leur défendit d’appeler des médecins. D’après Khrouchtchev, Beria, qui en tant que chef de la police savait que Staline avait prévu de le faire prochainement arrêter, avait tout intérêt à ne pas le faire soigner. Il est toutefois possible que Beria ait simplement voulu respecter la phobie que Staline éprouvait envers les médecins, qui l’avait amené à faire arrêter les siens quelques mois auparavant. Au bout d’une dizaine d’heures, il fut toutefois décidé de faire venir des docteurs qui ne surent que faire, si ce n’est prescrire de poser des sangsues au mourant pour réduire sa tension. Beria envoya aussi ses agents interroger dans les prisons les médecins que Staline avait fait arrêter : sur la base de la description clinique qui leur fut faite, ils expliquèrent qu’il n’y avait plus d’espoir et que la mort était inéluctable.
Toujours posé sur son lit, Staline s’asphyxiait lentement, sans recevoir aucun véritable soin. Le 4 mars, Malenkov décida qu’il fallait préparer la population au décès de son dirigeant suprême et la radio annonça à toute la population que l’état du camarade Staline était inquiétant. Le patriarche de Moscou et le grand rabbin appelèrent aussitôt les fidèles à une veillée de prière, avant que le 6 mars, à 4 heures du matin, la radio soviétique n’annonce que « le cœur du compagnon d’armes de Lénine, le porte-drapeau de son génie et de sa cause, le sage éducateur et guide du parti communiste et de l’Union soviétique, a cessé de battre le 5 mars 1953 à 21 h 50 ».
Tragiques funérailles
De nombreux témoignages attestent que l’annonce de la mort de Staline fut accueillie avec des cris de joie dans les camps de travail, qui regroupaient alors 2,5 millions de Soviétiques. Les archives soviétiques conservent aussi les procédures intentées contre plusieurs citoyen·ne·s, qui furent condamné·e·s à 10 ans de camp pour avoir accueilli avec enthousiasme la nouvelle du décès de Staline. Toutefois, la grande majorité de la population s’attacha à manifester, par prudence ou par sincérité, la très grande douleur que lui inspirait ce deuil.
Le corps de Staline fut déposé dans la salle des Colonnes de la Maison des syndicats, à l’endroit même où le corps de Lénine avait été exposé en 1924. Très vite, se forma une immense queue, longue de 16 km, permettant aux Moscovites en larmes de se recueillir devant le cadavre de Staline. Le 9 mars, les autorités organisèrent des funérailles, pour conduire le corps jusqu’au mausolée construit sur la Place Rouge, où il devait reposer auprès de Lénine, embaumé pour l’éternité. La foule était si nombreuse que la cérémonie tourna au drame, puisque 1 500 personnes moururent étouffées ou piétinées dans les épouvantables bousculades que suscita l’incurie habituelle de l’administration, qui n’avait pris aucune mesure pour contenir les millions de Soviétiques qu’elle avait fait venir pour les funérailles.
Un écho international
Tous les témoignages attestent que les militant·e·s et dirigeants communistes furent profondément choqué·e·s par l’annonce du décès de Staline. Des dirigeants aussi expérimentés que Mao et Zhou Enlai se mirent à pleurer lorsqu’ils apprirent la nouvelle. En Italie, le secrétaire général du PCI, Togliatti, était terriblement ému lorsqu’il vint annoncer le décès de Staline à la chambre des députés. Avec l’accord des autres parlementaires, il expliqua que les députés ne pouvaient pas continuer dans ce contexte leurs travaux, car un tel décès « étreint le cœur de toute l’humanité civilisée, puisqu’il n’est pas nécessaire d’avoir partagé les idées de Joseph Staline, d’avoir exalté ses œuvres, pour être frappé, étonné, au moment où cette vie prodigieuse prend fin ».
En France, où le gouvernement fit ordonner trois jours de deuil officiel, Jacques Duclos, qui dirigeait le PCF depuis le départ en 1950 de Thorez à Moscou, ne put lui non plus retenir ses sanglots lorsqu’il vint devant le comité central annoncer la mort de Staline. Le PCF fit recouvrir les sièges de ses locaux par d’immenses crêpes noirs, chargés des portraits de Staline, devant lesquels militant·e·s et travailleuses-eirs vinrent effondré·e·s se recueillir, déposer des fleurs et signer des registres de condoléances. Le culte de Staline se poursuivait jusque dans sa mort. Pour avoir publié un portrait non réaliste de Staline dans le numéro spécial que les Lettres françaises lui avait consacré, Picasso subit les foudres de la direction du PCF, et Aragon dut faire son autocritique, pour avoir laissé passer un portrait aussi peu conforme aux canons du réalisme socialiste dans la revue qu’il dirigeait.
L’ouverture de la succession
Peut-être parce qu’il se sentait mourir, Staline avait dans ses derniers mois renforcé sa poigne de fer sur la société. Il venait ainsi de lancer une campagne antisémite délirante, en faisant arrêter des dizaines de milliers de juifs-ves, au nom de la lutte contre le « cosmopolitisme ». Quatre mois avant sa mort, il avait fait publier en 20 millions d’exemplaires un ouvrage sur Les problèmes économiques du socialisme en URSS, dans lequel il annonçait son intention de supprimer les lopins individuels des kolkhosien·ne·s, autrement dit un retour à la grande terreur des années 1930. Sa paranoïa l’avait même amené à dissoudre en octobre le Politburo, avant d’annoncer que de nouvelles purges allaient frapper la direction, menaçant ouvertement Molotov et Mikoïan, dont les vies ne tenaient plus qu’à un fil.
Si Staline s’était employé à n’avoir jamais d’héritier, il fallut toutefois pourvoir à sa succession. Lors des funérailles, Malenkov, un petit bureaucrate sans aucune envergure dont Staline avait fait son numéro 2, sembla en mesure de prendre la direction, mais il lui fallut bien vite brider ses ambitions et dès le 15 mars il dut démissionner du secrétariat du comité central. Si une nouvelle direction se mettait en place, elle s’organisait sur le principe de la collégialité, en totale rupture avec l’époque stalinienne.
Un brutal changement d’époque
Très rapidement, les Soviétiques s’aperçurent que de profonds changements étaient en cours. Le 20 mars, la Pravda paraissait sans qu’une seule fois le nom de Staline n’apparaisse. Le 27 mars, Beria proclamait une amnistie et faisait libérer en quelques jours plus d’un million de prisonniers-ères. Le 6 avril, la Pravda annonçait non seulement que les médecins de Staline avaient été libérés, mais aussi que toutes les accusations montées contre eux étaient fausses et que les policiers qui les avaient torturés avaient été arrêtés. Le 16 avril, les lecteurs de la Pravda découvrirent incrédules un article qui soulignait l’importance de la démocratie et de la collégialité dans le parti, en expliquant que la critique devait pouvoir s’y exprimer librement.
Les dirigeants occidentaux assistèrent, eux aussi médusés, à une nette rupture de la politique extérieure de l’URSS. Le 19 mars, les Soviétiques annoncèrent qu’ils souhaitaient négocier avec les Chinois une paix en Corée, ouvrant le processus qui aboutit le 27 juillet 1953 au traité d’armistice de Panmunjom. Dans le même temps, les Soviétiques démantelaient les check-points qui bloquaient Berlin-Ouest, et ses diplomates ouvraient la perspective d’une réunification de l’Allemagne, en échange de sa neutralisation.
La fin d’un monde
Le cours nouveau des Soviétiques déstabilisa les pays dominés d’Europe centrale, où les petits Staline qui dirigeaient les partis communistes voyaient leurs nouveaux maîtres prendre une orientation en tout point opposée à la leur. En mai, des grèves ouvrières secouèrent la Bulgarie, puis l’agitation se propagea à la Tchécoslovaquie, où la ville de Plzen fut le cadre d’émeutes au début du mois de juin. à la mi-juin, des grèves insurrectionnelles éclataient à Berlin-Est ; elles prirent une telle ampleur, que l’armée russe tira sur les manifestant·e·s, faisant plus d’une centaine de mort·e·s. La disparition de Staline posait un problème majeur à la nouvelle direction : comment maintenir le système soviétique, tout en tournant la page du délirant régime stalinien ?
La rupture était en tout cas consommée et la nouvelle direction collégiale en donna une nouvelle preuve, lorsqu’elle fit arrêter à la fin du mois de juin 1953 Beria, l’homme qui avait pendant des années dirigé la police de Staline et incarnait pour tou·te·s les Soviétiques les pires dérives de ce régime. Jugé selon les plus pures normes des procès staliniens, condamné à mort et exécuté, Beria devint ainsi la victime expiatoire du système qu’il avait mis en place, celle qui montrait que Staline avait emporté dans sa tombe le terrorisme d’État par lequel il avait écrasé la société soviétique pendant un quart de siècle.
Article initialement publié sur l’Anticapitaliste, le 1er mars 2023
Image : 5 mars 1953, mort de Joseph Staline (source : flickr)